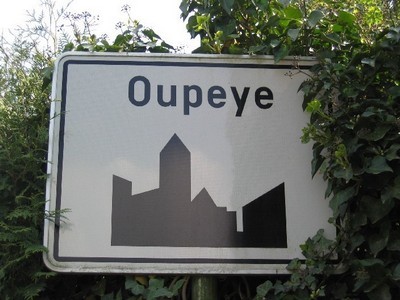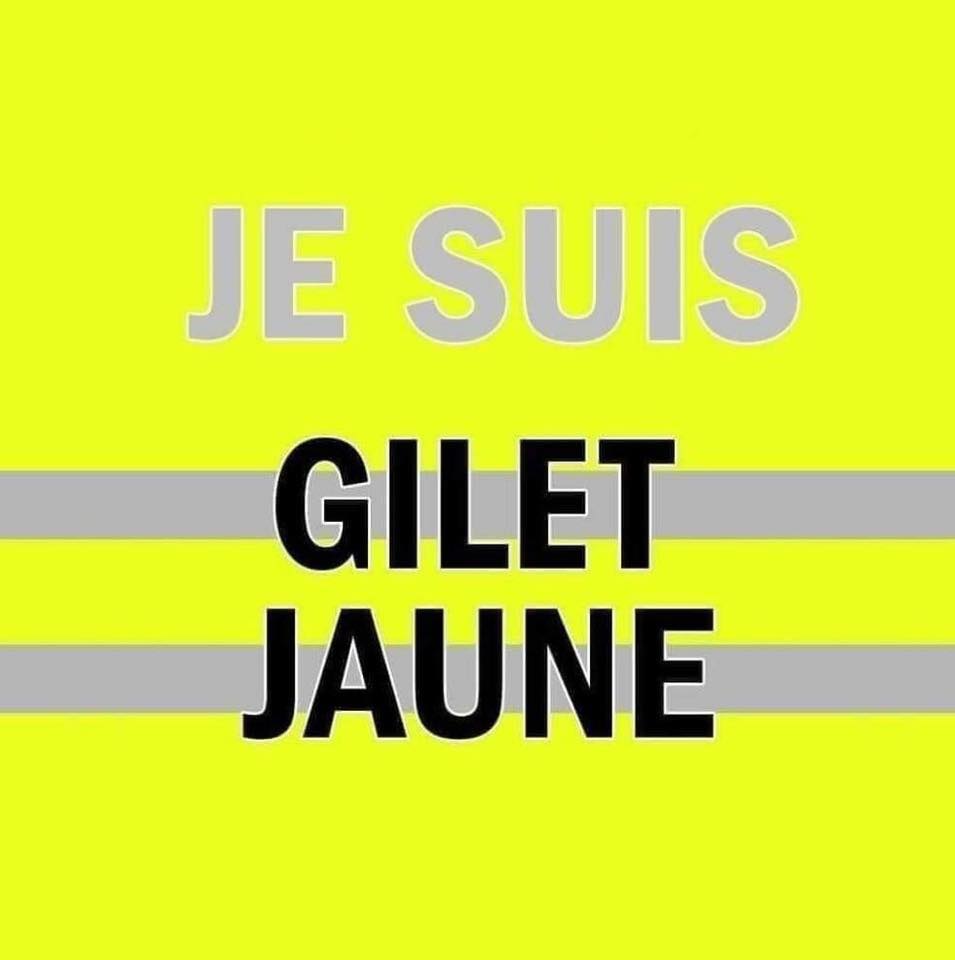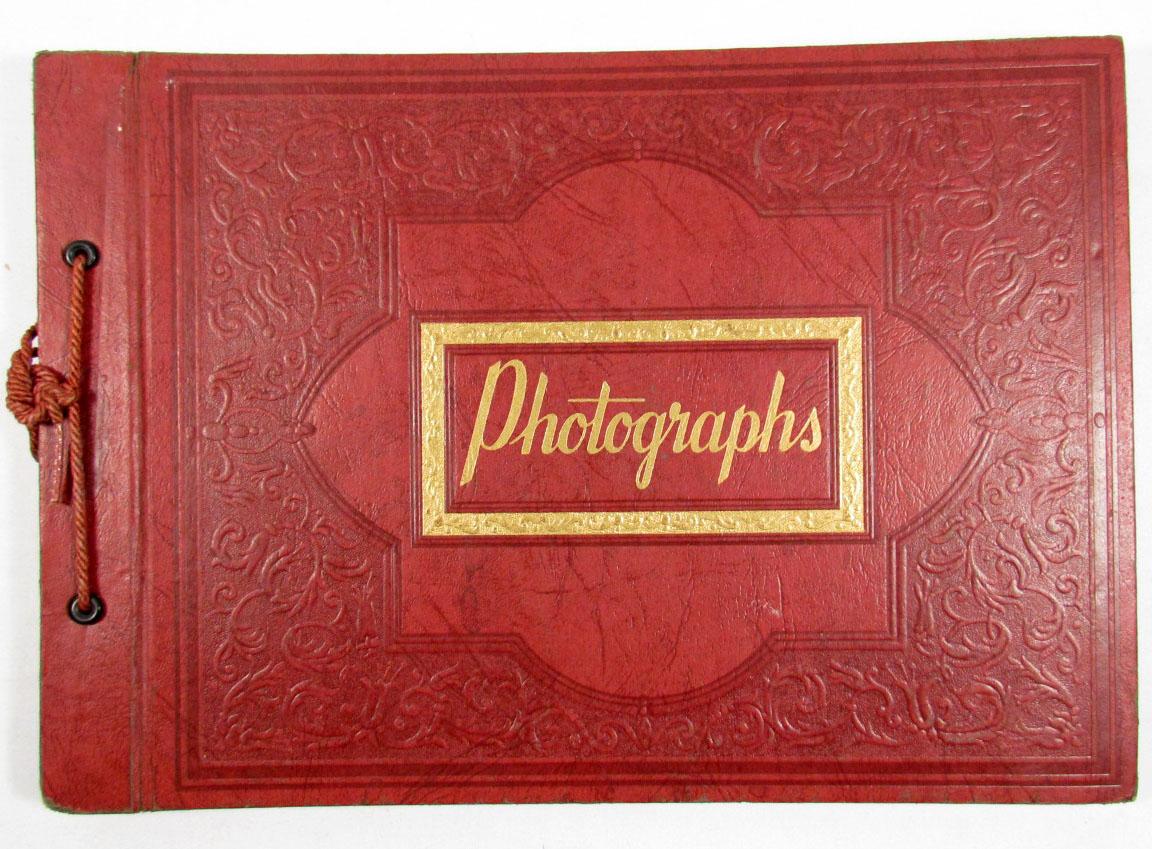PARKINSON
JIM 03 juillet 2025
Parkinson : trois signes non moteurs pour prédire la maladie
Anne-Céline Rigaud | 03 Juillet 2025
Une étude américaine sur 6108 hommes montre qu'une triade de symptômes non moteurs multiplie par 23 le risque de développer un Parkinson dans les 3 ans. Ces marqueurs prodromiques pourraient ouvrir la voie à un dépistage précoce en population générale.
La maladie de Parkinson progresse insidieusement pendant des années avant que les premiers symptômes moteurs ne permettent son diagnostic. A ce stade, l’altération des neurones dopaminergiques est déjà bien avancée, limitant l’efficacité des traitements. Identifier les patients durant cette phase précoce (ou prodromique) de la maladie représente ainsi un enjeu majeur pour améliorer la prise en charge de cette pathologie neurodégénérative.
Toute une gamme de signes non moteurs ont été décrits pendant cette phase prodromique, notamment des troubles neuropsychiatriques, du sommeil ou encore sensoriels. Des stratégies pour prédire la maladie de Parkinson, basées sur des combinaisons de caractéristiques, ont d’ores et déjà été proposées, mais ciblant des populations à haut risque (notamment selon un profil génétique spécifique).
Une nouvelle étude américaine prospective apporte des éléments encourageants en démontrant qu'une combinaison de trois symptômes non moteurs permet de prédire avec précision l'apparition de la maladie de Parkinson dans les années suivantes (1).
Une triade prédictive particulièrement discriminante
Cette étude longitudinale prospective a porté sur 6108 hommes âgés de 40 à 75 ans, professionnels de santé, de la cohorte HPFS (Health Professionals Follow-Up Study) aux Etats-Unis, avec des évaluations répétées en 2012, 2014 et 2017. A partir des données de la littérature, sept caractéristiques non motrices ont été étudiées (constipation, trouble du comportement en sommeil paradoxal, hyposmie, altération de la vision des couleurs, somnolence diurne, douleurs corporelles et symptômes dépressifs), dont trois se sont révélées particulièrement discriminantes. Des mesures composites ont également été calculées.
La co-occurrence de la constipation, d’un trouble du comportement en sommeil paradoxal (TCSP) et de l'hyposmie multiplie par 23 le risque de diagnostic de Parkinson dans les trois années suivantes (RR = 23,35 [IC 95 % : 10,62-51,33]). Cette association reste statistiquement significative même après ajustement sur les facteurs de risque et protecteurs connus, tels que le tabagisme, l’activité physique, la consommation de caféine et le diabète, avec un risque relatif de 25,33 [11,60-55,32].
Au cours d’un suivi moyen de 3,4 années, 103 participants ont développé une maladie de Parkinson. Parmi les hommes présentant la triade symptomatique (constipation, TCSP, hyposmie), 12,5 % [6,6-18,4] ont évolué vers un Parkinson cliniquement manifeste dans les trois ans, contre seulement 0,5 % dans le groupe indemne de ces caractéristiques.
Validation des critères MDS et identification de sous-types prodromiques
L'étude valide également l'approche bayésienne développée par la Movement Disorders Society (MDS), qui intègre facteurs de risque et marqueurs prodromiques (2). Les hommes avec une probabilité de Parkinson prodromique ≥ 0,8 selon ces critères présentent un risque 21 fois supérieur comparativement à ceux avec une probabilité < 0,2 (RR = 21,96 [11,17-43,17]). La cooccurrence des 3 caractéristiques non motrices et une probabilité basée sur le MDS (≥ 0,8) avaient des valeurs prédictives comparables et étaient des prédicteurs plus forts que n’importe laquelle des caractéristiques prise isolément. Ainsi, la proportion d’individus qui se sont phénoconvertis dans les 3 ans était de 12,5 % chez les hommes présentant les 3 caractéristiques non motrices, et de 13,9 % (IC à 95 % = 8,5 à 19,5) chez les hommes atteints de la maladie de parkinson prodromique probable.
L'analyse temporelle montre une progression notable des symptômes dans les deux années précédant le diagnostic : la proportion d'individus présentant la triade symptomatique passe de 13% à 22%, tandis que le score médian MDS double. Cette évolution confirme l'intérêt d'un suivi longitudinal pour optimiser la prédiction.
Les associations se révèlent particulièrement robustes chez les hommes âgés de moins de 75 ans, suggérant une meilleure performance prédictive dans cette population. Cette observation pourrait orienter les stratégies de dépistage vers les sujets plus jeunes présentant ces caractéristiques prodromiques.
Deux sous-types distincts de Parkinson prodromiques ont par ailleurs été identifiés pour lesquels le TCSP et l’altération de la vision des couleurs constituaient les éléments discriminants principaux. Ces données suggèrent une hétérogénéité de la phase prodromique qui pourrait orienter vers des stratégies thérapeutiques personnalisées.
Cette étude prospective, qui ne porte que sur des hommes professionnels de santé cependant, démontre pour la première fois qu'une évaluation simple de symptômes non moteurs pourrait identifier avec une bonne précision les individus à risque de développer une maladie de Parkinson. La valeur prédictive de ces outils comparable à celle des tests de dépistage du cancer colorectal ou prostatique, ouvre des perspectives concrètes pour l'implémentation de stratégies de dépistage populationnel, si elle est confirmée dans une population plus variée.
Ces résultats pourraient révolutionner l'approche préventive de la maladie de Parkinson en permettant l'identification précoce des patients candidats aux essais thérapeutiques de neuroprotection, avant l'apparition des lésions irréversibles.
References
(1) Flores-Torres MH, Hughes KC, Cortese M, et al. Identifying Individuals in the Prodromal Phase of Parkinson's Disease: A Prospective Cohort Study. Ann Neurol. 2025 Apr;97(4):720-729. doi: 10.1002/ana.27166.
(2) Heinzel S, Berg D, Gasser T, et al ; MDS Task Force on the Definition of Parkinson's Disease. Update of the MDS research criteria for prodromal Parkinson's disease. Mov Disord. 2019 Oct;34(10):1464-1470. doi: 10.1002/mds.27802.
Dans le JIM du 30 juillet 2025
Parkinson : mieux vaut être de droite ou de gauche ?
Dr Philippe Tellier | 30 Juillet 2025
Une revue systématique de 80 études révèle que l'asymétrie motrice initiale de la maladie de Parkinson prédit les troubles non moteurs : l’atteinte droite serait davantage associée au risque cognitif, l’atteinte gauche aux troubles psychiatriques.
La maladie de Parkinson idiopathique (MPI) se caractérise par une dégénérescence des circuits dopaminergiques qui est à l’origine de signes moteurs bien connus. Au début de la maladie, ces derniers sont volontiers unilatéraux du fait d’un déficit dopaminergique encore modéré qui affectera par la suite les striatums dans leur quasi-totalité. Cette asymétrie mérite-t-elle d’être prise en compte pour prédire le pronostic fonctionnel ? Dans quelle mesure retentit-elle sur l’apparition et l’évolution des signes non moteurs qui contribuent largement à la morbidité ?
Revue systématique de la littérature internationale
Une revue systématique de la littérature internationale répond à ces questions au travers de l’analyse de quatre-vingts publications diverses et variées : études d’observation, ou d’imagerie (IRM fonctionnelle), évaluations neuropsychologiques ou thérapeutiques (stimulation cérébrale profonde), etc. Les bases de données PubMed, Scopus et Web of Science ont été interrogées jusqu’en avril 2025. Les liens éventuels entre l’asymétrie motrice initiale et les divers signes non moteurs (cognitifs, émotionnels, comportementaux ou encore psychiatriques) ont été systématiquement explorés en suivant les standards du protocole PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Les patients ont été classés en fonction de la latéralisation des signes moteurs.
Latéralité des signes moteurs et profil neuropsychiatrique
En cas de déficit dopaminergique gauche et, de fait, de signes moteurs prédominant sur l’hémicorps droit, le risque de déclin cognitif semble significativement accru au travers notamment de troubles du langage ( fluidité verbale, dénomination), d’altérations de la mémoire verbale et des fonctions exécutives (flexibilité mentale, perte de l’inhibition, défaut de planification), la vitesse de traitement de l’information étant par ailleurs diminuée. Les préoccupations cognitives l’emportent sur les manifestations thymiques. Autant de signes qui témoignent de l’atteinte préférentielle des aires préfrontales gauches et des circuits fronto-striataux associés.
En cas de déficit dopaminergique présynaptique droit avec atteinte motrice de l’hémicorps gauche, les troubles neurologiques non moteurs consistent en une altération de la reconnaissance des émotions faciales, en particulier de la peur et de la colère, ainsi qu’une moindre réactivité émotionnelle. Les troubles neuropsychiatriques sont également plus fréquents dans cette configuration neurobiologique, qu’il s’agisse de la dépression, de l’anxiété, des pensées négatives –avec perception d’une qualité de vie altérée- ou encore de la démence, sans préjuger de son type. La tendance est également à une impulsivité accrue et aux troubles visuospatiaux, affectant la navigation dans l’espace ou la représentation visuelle et subjective de ce dernier. Toute une sémiologie qui est le reflet du rôle traditionnellement dévolu à l’hémisphère droit dans le traitement des émotions et des interactions sociales, la désinhibition des circuits orbitofrontaux droits étant également de la partie. Les troubles du contrôle des impulsions semblent un peu plus fréquents dans l’atteinte striatale droite, quoique présents dans l’atteinte hémisphérique gauche.
La réponse à divers traitements est en partie conditionnée par la latéralité de l’atteinte motrice : ainsi, l’efficacité de la L-Dopa pourrait varier selon l’asymétrie initiale, en modulant différemment les réseaux impliqués et les signes cliniques, le bénéfice cognitif étant moins patent en cas d’atteinte hémisphérique gauche, à la différence de l’apathie. Il en irait de même pour la stimulation cérébrale profonde, le déclin cognitif après cette intervention, notamment pour ce qui est de la verbalisation, étant plus marqué en cas d’atteinte hémisphérique droite. A l’inverse, cette dernière aurait un impact plus favorable sur la cognition sociale et la régulation des émotions en cas d’atteinte hémisphérique gauche.
Des perspectives et des limites
De facto, la latéralité des signes moteurs annoncerait, dans une certaine mesure, la survenue de troubles non moteurs qui ont un impact décisif sur le pronostic à long terme de la maladie de Parkinson. Des troubles moteurs gauches seraient associés à un risque accru de déclin cognitif, alors que l’atteinte motrice droite exposerait plutôt aux manifestations psychiatriques impliquant les interactions sociales et les comportements. L’asymétrie motrice pourrait même contribuer au choix de telle ou telle stratégie thérapeutique, une perspective qui reste à affiner.
Les informations issues de cette étude méritent d’être nuancées, du fait de limites méthodologiques évidentes : le manque d’uniformité dans la définition de l’asymétrie motrice doit être souligné, de même que l’absence de prise en compte des traitements et de leur impact neurocognitif, sans omettre l’hétérogénéité des outils d’évaluation des fonctions cognitives et des troubles psychiatriques.
References
Voruz P, Guérin D, Péron JA. Impact of motor symptom asymmetry on non-motor outcomes in Parkinson's disease: a systematic review. NPJ Parkinsons Dis. 2025 Jul 1;11(1):188. doi: 10.1038/s41531-025-01046-4.
Dans le JIM du 21 juillet 2025
Parkinson et troubles du contrôle des impulsions : la sérotonine suspectée
Dr Philippe Tellier | 21 Juillet 2025
Une étude TEP montre que les troubles du contrôle des impulsions chez les parkinsoniens ne résultent pas uniquement d'un dysfonctionnement dopaminergique, mais aussi d'une dysrégulation sérotoninergique des circuits moteurs et associatifs.
Les troubles du contrôle des impulsions (TCI) (jeux pathologiques, achats compulsifs, hypersexualité, accès d’hyperphagie etc.) sont fréquemment constatés chez les patients atteints d’une maladie de Parkinson idiopathique (MPI), notamment en cas de traitement par les agonistes dopaminergiques. Cela étant, il semble bien que la voie de la dopamine ne soit la seule à être impliquée dans la pathogénie des TCI dans un tel contexte. La sérotonine, neurotransmetteur qui module l’inhibition comportementale tout autant que la prise de décision raisonnée, aurait son mot à dire. Comment fonctionnent les voies sérotoninergiques chez les parkinsoniens quand surviennent des TCI ? L’imagerie cérébrale permet-elle d’objectiver leur dysfonctionnement ? Ce dernier mérite-t-il d’être pris en compte sur un plan thérapeutique ?
Une petite étude transversale : 45 participants
Une petite étude transversale du type cas-témoins apporte des éléments de réponse à ces questions. Ont été inclus 45 participants répartis en trois groupes : (1) MPI avec TCI (n = 15) (MPI/TCI+) ; (2) MPI sans TCI (n = 15) (MPI/TCI-); (3) témoins (n = 15).
Les voies sérotoninergiques ont été étudiées dans tous les cas au moyen de la tomographie par émission de positons (TEP), deux radiopharmaceutiques étant utilisés lors d’explorations séparées mais proches dans le temps : le ¹¹C‑DASB (transporteur présynaptique de la sérotonine) et la ¹⁸F‑altanserine (marqueur du récepteur 5‑HT₂ A postsynaptique).
Le DASB (N,N-Dimethyl-2-(2-amino-4-cyanophenylthio)benzylamine) marqué au carbone 11 (¹¹C-DASB) est actuellement le radiotraceur considéré comme le gold standard dans l’exploration du système sérotoninergique présynaptique par TEP. La ¹⁸F‑altansérine, pour sa part, explore la voie sérotoninergique sur son versant postsynaptique : sans être un traceur de référence, elle n’en est pas moins appréciée en recherche clinique, la demi-vie physique du fluor 18 de 110 minutes étant moins contraignante que celle du carbone 11, de l’ordre de 20 minutes. La logistique des explorations s’en trouve considérablement améliorée, une demi-vie trop brève transformant l’opération en course contre la montre.
Une dysrégulation du système sérotoninergique
La comparaison intergroupe des données de l’imagerie TEP avec double marquage révèle que dans le groupe MPI-TCI+, la liaison du ¹¹C‑DASB est plus élevée dans le putamen postérieur et le pallidum, en comparaison avec le groupe MPI/TCI-. Un résultat qui plaide en faveur du maintien du tonus sérotoninergique dans les circuits moteurs sensoriels, malgré la dégénérescence globale typique de la MPI.
Par ailleurs, l’imagerie TEP par ¹⁸F‑altanserine révèle que, dans le même groupe (MPI/TCI+), la fixation de ce traceur est augmentée dans plusieurs régions cérébrales associées à l’inhibition motrice et cognitive, qu’il s’agisse de l’aire motrice supplémentaire, du gyrus précentral ou encore du cortex préfrontal dorsolatéral droit. Un résultat qui plaide en faveur d’un dysfonctionnement sérotoninergique post-synaptique compensateur ou inadapté.
Par ailleurs, une corrélation neuro-anatomique entre la topographie de la dysfonction sérotoninergique et les sous-types de TCI en termes d’impulsivité d’action (circuits sensorimoteurs) et de décision (circuits associatifs frontostriataux) est mise en évidence.
Le rôle pathogénique de la sérotonine dans la maladie de Parkinson : à évaluer et réévaluer
Cette étude d’imagerie élégante qui repose entièrement sur la TEP est la première à fournir la preuve directe d’une implication du système sérotoninergique dans la pathogénie des troubles du contrôle des impulsions associés à la maladie de Parkinson idiopathique. Ces troubles ne résultent pas uniquement d’une dysrégulation dopaminergique limbique, mais aussi d’un dysfonctionnement sérotoninergique impliquant les circuits moteurs et associatifs. Des résultats qui permettent aussi de se remémorer que la MPI ne se résume pas à une atteinte des voies dopaminergiques présynaptiques. Les neurones sérotoninergiques subissent une dégénérescence qui précède de longue date celle de leurs homologues dopaminergiques et s’accompagne de nombreux signes non moteurs et non spécifiques de cette maladie neurodégénérative. Le rôle de la voie sérotoninergique dans l’atteinte ultérieure des voies dopaminergiques fait partie des hypothèses pathogéniques actuelles qui laissent à penser que la maladie de Parkinson pourrait bien relever en partie et en primum movens d’un dysfonctionnement sérotoninergique inaugural, a fortiori quand il existe un TCI, syndrome qui peut faire partie des manifestations non motrices de la maladie. Les perspectives thérapeutiques se dessinent progressivement, même si elles apparaissent encore bien lointaines, face aux difficultés rencontrées pour diagnostiquer précocement les formes non motrices de la MPI.
References
Prange S, Metereau E, Klinger H, et al. Serotonergic dysfunction in patients with impulse control disorders in Parkinson's disease. Brain. 2025 Jun 3;148(6):2108-2121. doi: 10.1093/brain/awaf087.
Dans le Journal International de la Médecine du 3 juillet 2025
Parkinson : trois signes non moteurs pour prédire la maladie
Anne-Céline Rigaud | 03 Juillet 2025
Une étude américaine sur 6108 hommes montre qu'une triade de symptômes non moteurs multiplie par 23 le risque de développer un Parkinson dans les 3 ans. Ces marqueurs prodromiques pourraient ouvrir la voie à un dépistage précoce en population générale.
La maladie de Parkinson progresse insidieusement pendant des années avant que les premiers symptômes moteurs ne permettent son diagnostic. A ce stade, l’altération des neurones dopaminergiques est déjà bien avancée, limitant l’efficacité des traitements. Identifier les patients durant cette phase précoce (ou prodromique) de la maladie représente ainsi un enjeu majeur pour améliorer la prise en charge de cette pathologie neurodégénérative.
Toute une gamme de signes non moteurs ont été décrits pendant cette phase prodromique, notamment des troubles neuropsychiatriques, du sommeil ou encore sensoriels. Des stratégies pour prédire la maladie de Parkinson, basées sur des combinaisons de caractéristiques, ont d’ores et déjà été proposées, mais ciblant des populations à haut risque (notamment selon un profil génétique spécifique).
Une nouvelle étude américaine prospective apporte des éléments encourageants en démontrant qu'une combinaison de trois symptômes non moteurs permet de prédire avec précision l'apparition de la maladie de Parkinson dans les années suivantes.
Une triade prédictive particulièrement discriminante
Cette étude longitudinale prospective a porté sur 6108 hommes âgés de 40 à 75 ans, professionnels de santé, de la cohorte HPFS (Health Professionals Follow-Up Study) aux Etats-Unis, avec des évaluations répétées en 2012, 2014 et 2017. A partir des données de la littérature, sept caractéristiques non motrices ont été étudiées (constipation, trouble du comportement en sommeil paradoxal, hyposmie, altération de la vision des couleurs, somnolence diurne, douleurs corporelles et symptômes dépressifs), dont trois se sont révélées particulièrement discriminantes. Des mesures composites ont également été calculées.
La co-occurrence de la constipation, d’un trouble du comportement en sommeil paradoxal (TCSP) et de l'hyposmie multiplie par 23 le risque de diagnostic de Parkinson dans les trois années suivantes (RR = 23,35 [IC 95 % : 10,62-51,33]). Cette association reste statistiquement significative même après ajustement sur les facteurs de risque et protecteurs connus, tels que le tabagisme, l’activité physique, la consommation de caféine et le diabète, avec un risque relatif de 25,33 [11,60-55,32].
Au cours d’un suivi moyen de 3,4 années, 103 participants ont développé une maladie de Parkinson. Parmi les hommes présentant la triade symptomatique (constipation, TCSP, hyposmie), 12,5 % [6,6-18,4] ont évolué vers un Parkinson cliniquement manifeste dans les trois ans, contre seulement 0,5 % dans le groupe indemne de ces caractéristiques.
Validation des critères MDS et identification de sous-types prodromiques
L'étude valide également l'approche bayésienne développée par la Movement Disorders Society (MDS), qui intègre facteurs de risque et marqueurs prodromiques. Les hommes avec une probabilité de Parkinson prodromique ≥ 0,8 selon ces critères présentent un risque 21 fois supérieur comparativement à ceux avec une probabilité < 0,2 (RR = 21,96 [11,17-43,17]). La cooccurrence des 3 caractéristiques non motrices et une probabilité basée sur le MDS (≥ 0,8) avaient des valeurs prédictives comparables et étaient des prédicteurs plus forts que n’importe laquelle des caractéristiques prise isolément. Ainsi, la proportion d’individus qui se sont phénoconvertis dans les 3 ans était de 12,5 % chez les hommes présentant les 3 caractéristiques non motrices, et de 13,9 % (IC à 95 % = 8,5 à 19,5) chez les hommes atteints de la maladie de parkinson prodromique probable.
L'analyse temporelle montre une progression notable des symptômes dans les deux années précédant le diagnostic : la proportion d'individus présentant la triade symptomatique passe de 13% à 22%, tandis que le score médian MDS double. Cette évolution confirme l'intérêt d'un suivi longitudinal pour optimiser la prédiction.
Les associations se révèlent particulièrement robustes chez les hommes âgés de moins de 75 ans, suggérant une meilleure performance prédictive dans cette population. Cette observation pourrait orienter les stratégies de dépistage vers les sujets plus jeunes présentant ces caractéristiques prodromiques.
Deux sous-types distincts de Parkinson prodromiques ont par ailleurs été identifiés pour lesquels le TCSP et l’altération de la vision des couleurs constituaient les éléments discriminants principaux. Ces données suggèrent une hétérogénéité de la phase prodromique qui pourrait orienter vers des stratégies thérapeutiques personnalisées.
Cette étude prospective, qui ne porte que sur des hommes professionnels de santé cependant, démontre pour la première fois qu'une évaluation simple de symptômes non moteurs pourrait identifier avec une bonne précision les individus à risque de développer une maladie de Parkinson. La valeur prédictive de ces outils comparable à celle des tests de dépistage du cancer colorectal ou prostatique, ouvre des perspectives concrètes pour l'implémentation de stratégies de dépistage populationnel, si elle est confirmée dans une population plus variée.
Ces résultats pourraient révolutionner l'approche préventive de la maladie de Parkinson en permettant l'identification précoce des patients candidats aux essais thérapeutiques de neuroprotection, avant l'apparition des lésions irréversibles.
References
Flores-Torres MH, Hughes KC, Cortese M, et al. Identifying Individuals in the Prodromal Phase of Parkinson's Disease: A Prospective Cohort Study. Ann Neurol. 2025 Apr;97(4):720-729. doi: 10.1002/ana.27166.
Date de dernière mise à jour : 09/08/2025
Ajouter un commentaire