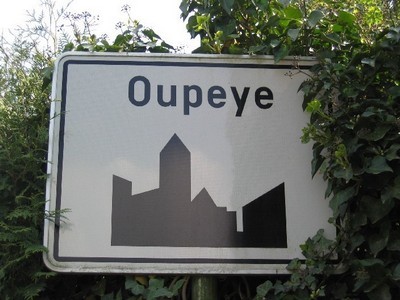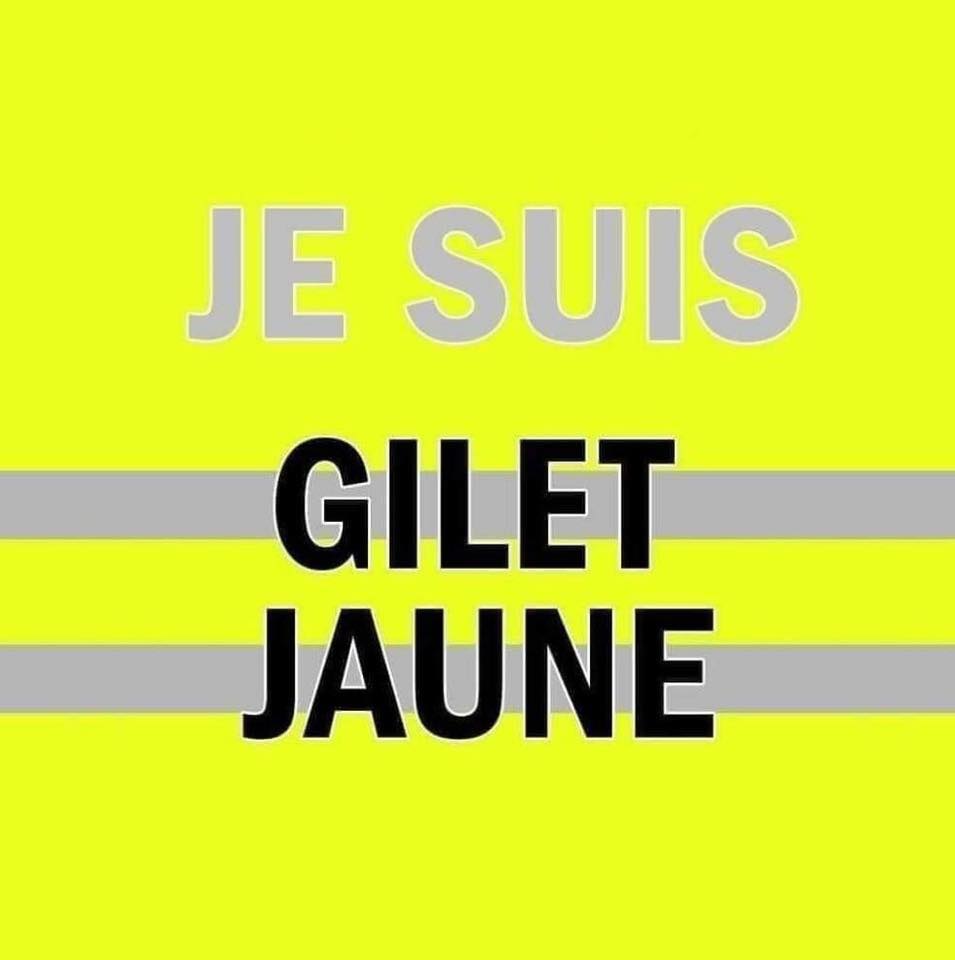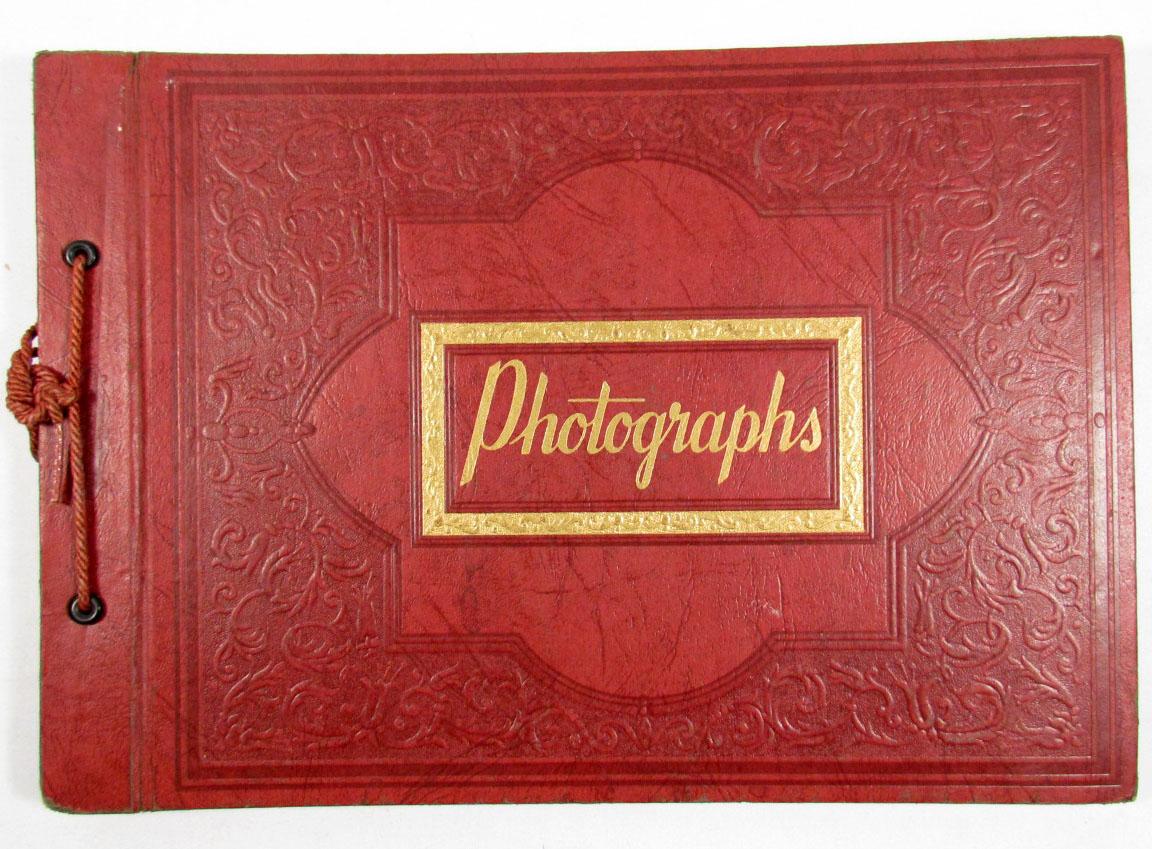PARKINSON & ALZHEIMER
Journal International de Médecine - 4 septembre 2025
Alzheimer : quand la réserve cognitive se retourne contre le cerveau
Dr Philippe Tellier | 04 Septembre 2025
Paradoxe de la réserve cognitive : une étude internationale suggère qu'un haut niveau d'éducation, initialement protecteur, devient un facteur d'accélération de la pathologie tau une fois les plaques amyloïdes installées chez les patients Alzheimer.
L'hypothèse selon laquelle une réserve cognitive élevée protègerait contre la maladie d'Alzheimer (MA) fait l'objet d'un large consensus, bien qu'elle repose sur des fondements épidémiologiques fragiles. Les individus ayant un niveau d'éducation supérieur sembleraient mieux tolérer les lésions neuropathologiques et présenter un déclin cognitif retardé. Cette apparente protection soulève cependant une question fondamentale : comment la réserve cognitive influence-t-elle réellement les processus pathologiques une fois la cascade amyloïde enclenchée, notamment la formation des enchevêtrements de protéine tau ?
Les plaques amyloïdes (Aβ) et les enchevêtrements neurofibrillaires de tau constituent les deux marqueurs centraux de la MA, détectables par tomographie par émission de positons ( TEP). Contrairement à l'amyloïde, tau présente une corrélation étroite avec la neurodégénérescence et le déclin cognitif. Son accumulation suit la classification de Braak, l'amyloïde initiant sa propagation depuis les régions temporales médiales vers les aires corticales connectées.
Plusieurs facteurs accélèrent l'accumulation de tau : âge plus jeune, sexe féminin, prédispositions génétiques et comorbidités vasculaires. Le niveau d'éducation, proxy de la réserve cognitive, occupe une position particulière. Bien que corrélé à de meilleures performances cognitives et à une connectivité cérébrale optimisée, son association avec la protéine tau demeure mal caractérisée.
Les études apportent des résultats contradictoires : certaines ne trouvent aucune association significative, d'autres suggèrent qu'un niveau d'éducation élevé pourrait paradoxalement s'associer à une charge tau plus importante dans les régions temporo-pariétales. Les avancées en connectomique révèlent que l'accumulation de tau suit les patterns de connectivité des "épicentres tau", suggérant que les circuits neuronaux orchestrent sa propagation. Ces outils offrent une opportunité unique d'élucider comment l'éducation influence l'accumulation et la propagation de tau.
Une étude récente publiée dans JAMA Neurology fournit une réponse troublante : un niveau d'éducation élevé serait, quand l’imagerie moléculaire révèle une charge amyloïde élevée au sein du cortex associatif, associé à une accumulation et à une propagation plus rapides de la protéine tau.
Des données multicentriques et multiethniques, une méthodologie complexe
Cette étude multicentrique combine les données de trois cohortes longitudinales : ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative) en Amérique du Nord, A4 (Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic Alzheimer's Disease) et GHABS (Greater-Bay-Area Healthy Aging Brain Study) en Chine du Sud, totalisant 887 participants.
Les participants présentaient à l’inclusion des statuts cognitifs variables (cognition normale, déficit cognitif léger, MA débutante/confirmée) et devaient disposer d'une TEP-amyloïde (18F-florbetapir, 18F-florbetaben ou 18F-D3FSP), d'une IRM T1 3D dans l'année, et d'au moins deux TEP-tau (18F-flortaucipir) pour l'analyse longitudinale. Un sous-groupe bénéficiait d'une IRM fonctionnelle (IRMf) de repos et de dosages plasmatiques de la protéine tau phosphorylée (p-tau217), biomarqueur associé à la MA.
Le statut amyloïde positif (Aβ+) était défini par des seuils SUVR spécifiques à chaque traceur (≥1,11 pour FBP, ≥1,08 pour FBB, ≥0,78 pour FSP), excepté dans A4 où une évaluation visuelle qualitative était utilisée. Le niveau d'éducation était dichotomisé selon la médiane d'années d'études par cohorte et statut amyloïde (variant de 11 à 17 ans selon les groupes).
La propagation de tau connectivité-dépendante était quantifiée en corrélant la connectivité fonctionnelle avec le cortex entorhinal (épicentre de tau) et les taux d'accumulation de tau dans 198 régions de Schaefer, générant un indice global (β Global) et des indices régionaux selon les stades de Braak.
Des modèles mixtes linéaires ont estimé les changements annuels de tau-TEP, avec ajustement pour l'âge, le sexe, le statut APOE-ε4 et le diagnostic clinique. Les interactions entre statut amyloïde, niveau d'éducation et facteurs biologiques (charge amyloïde, tau entorhinal, p-tau217 plasmatique) sur l'accumulation de tau ont été analysées. Une analyse secondaire dans la cohorte A4 a exploré l'effet du solanezumab sur l'accumulation de tau selon le niveau d'éducation.
Il faut souligner que les protocoles d'acquisition scintigraphique, bien qu'harmonisés, présentaient des variations inter-centres, notamment pour les critères de positivité. Il en va d’ailleurs de même pour l’IRMf. Des divergences méthodologiques qui doivent être soulignées, tout autant que la complexité des techniques d’imagerie diversement utilisées par les investigateurs, avec des limites intrinsèques.
Aβ-positifs versus Aβ-négatifs : une nuance qui fait la différence
Comment les plaques tau s’accumulent-elles dans le temps en fonction du niveau d’éducation et des données initiales de l’imagerie des plaques amyloïdes ? Pour répondre à cette question, deux groupes de participants ont été constitués, selon la positivité ou non de la TEP amyloïde, autrement dit Aβ-positifs versus Aβ-négatifs. Le suivi moyen a été compris entre une année et 4,7 années.
Chez les patients Aβ-négatifs, un niveau d’éducation élevé était associé à une accumulation plus lente de la protéine tau, notamment au sein du cortex entorhinal, à l’inverse de ce qui a été observé chez les Aβ-positifs de niveau éducatif comparable : dans leur cas, l’accumulation du marqueur des plaques tau s’est avérée plus rapide (notamment dans le cortex temporo-pariétal et les aires visuelles) et corrélée à l’augmentation des biomarqueurs plasmatiques, notamment de la protéine p-tau217. Par ailleurs, cette évolution péjorative a été associée à une augmentation de la connectivité fonctionnelle centrée sur l’épicentre de propagation de la protéine tau. Dans l’essai A4, l’anticorps anti-amyloïde a été associé à une moindre accumulation de tau liée à p-tau217 chez les patients atteints d’une MA parmi ceux ayant le niveau d'éducation le plus élevé. Il faut cependant souligner que la significativité de ces associations tend à s’atténuer très nettement à l’aune des comparaisons multiples.
Comment interpréter ce paradoxe apparent ?
L’interprétation élégante, quoique fragile, de ce paradoxe fait appel à un modèle connectomique qui doit beaucoup à l’IRMf. Les auteurs avancent de fait une hypothèse originale : la connectivité fonctionnelle accrue observée chez les sujets les plus éduqués favoriserait la propagation trans-synaptique des agrégats de protéine tau, à la manière d'une "autoroute neurodégénérative". L'éducation devient ici un facteur de vulnérabilité secondaire, facilitant la dissémination corticale des dépôts de protéine tau.
Cette observation pourrait expliquer pourquoi certains patients très stimulés sur le plan intellectuel présentent un déclin brutal une fois le seuil d’expression clinique atteint. En pratique, elle suggère que les sujets Aβ+ à haut niveau d'éducation pourraient bénéficier précocement de traitements anti-amyloïdes pour prévenir l'effet amplificateur de la connectivité fonctionnelle sur la taupathie.
Une remise en question des dogmes et des idées reçues ?
Cette étude ne remet pas en cause les bénéfices cognitifs de l'éducation. La réserve cognitive ne serait pas un bouclier uniforme, mais un mécanisme neurophysiologique dynamique capable de moduler la trajectoire de la maladie en fonction de l'état biologique du cerveau
Loin de disqualifier le concept de réserve cognitive, ces résultats incitent à l'enrichir. Ils réintroduisent de la complexité dans notre compréhension des phénomènes neurodégénératifs, où l'éducation, la connectivité et la pathologie interagissent selon des logiques non linéaires. Le cerveau hautement connecté ne serait pas nécessairement un cerveau mieux protégé, surtout quand la maladie est déjà présente. Autant d’hypothèses séduisantes qui ne doivent pas faire oublier la complexité méthodologique de ce travail et la nécessité de répliquer de tels résultats avant de tomber dans des supputations thérapeutiques un peu prématurées.
References
Cai Y, Fang L, Yang J, et al ; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative Group. Higher Educational Attainment and Accelerated Tau Accumulation in Alzheimer Disease. JAMA Neurol. 2025 Jul 7;82(8):848–58. doi: 10.1001/jamaneurol.2025.1801.
PARKINSON ET POLLUTION
Parkinson : une mauvaise inspiration
Dr Philippe Tellier | 27 Août 2025
La pollution de l'air, déjà accusée dans les maladies cardiovasculaires et respiratoires, pourrait-elle aussi favoriser la maladie de Parkinson ? Une cohorte de 5 millions de Taïwanais apporte des éléments troublants sur ce lien encore débattu.
La pathogénie de la maladie de Parkinson s’avère complexe. Elle relève en effet d’interactions entre le vieillissement et des facteurs autant génétiques qu’environnementaux. Il semble que les agrégatsd’α-synucléine caractéristiques de la maladie se forment initialement dans le bulbe olfactif ou encore le tractus gastro-intestinal, comme le suggèrent certains modèles expérimentaux. L’inhalation de substances potentiellement toxiques pourrait favoriser l’apparition ou la progression de cette maladie neurodégénérative dont la prévalence mondiale ne cesse d’augmenter. La pollution atmosphérique, qui est impliquée dans la pathogénie de nombreuses maladies chroniques et de leur mortalité, pourrait-elle contribuer à celle de la maladie de Parkinson ?
Des discordances aisément explicables
Les principaux polluants atmosphériques (particules fines <2,5 μm ou PM2.5, NO₂, SO₂ ou encore ozone) sont, pour certains, à même de promouvoir la formation et la progression d’agrégats d’ α-synucléine au sein du bulbe olfactif, tout au moins dans des modèles murins. En revanche, sur le plan épidémiologique, les données sont beaucoup moins convaincantes : certaines études plaident en faveur d’une association positive entre l’exposition aux polluants atmosphériques liés au trafic automobile et le risque de maladie de Parkinson, alors que d’autres concluent à l’absence de toute relation significative. Ces discordances ne sauraient surprendre, compte tenu des fluctuations méthodologiques nombreuses : taille de l’échantillon, rôle variable du trafic, région du monde concernée (la pollution étant plus élevée en Asie qu’en Europe ou en Amérique du Nord), exposition individuelle variable aux polluants etc. Autant de facteurs qui conduisent à des divergences dans les protocoles et l’évaluation des associations, sans omettre les critères retenus pour définir la maladie de Parkinson. Pourtant, il y a potentiellement dans l’air inspiré des polluants capables d’interagir entre eux et d’aboutir à un effet cocktail : tel est le cas des molécules de SO2 et de NO2, capables de s’unir aux PM2.5 et à l’ozone (O3) pour former des aérosols particulièrement nocifs.
Une cohorte taïwanaise de plus de cinq millions de participants
Une étude taïwanaise apporte sa contribution à l’approche épidémiologique des associations entre pollution atmosphérique et maladie de Parkinson. Six polluants majeurs ont été pris en compte : PM2.5, PM10, NO2, CO, SO2 et O3. Leurs concentrations moyennes quotidiennes dans l’air ont été déterminées heure par heure par un organisme national, en l’occurrence la TEPA (Taiwan Environmental Protection Administration), à partir de 73 sites chargés de surveiller la qualité de l’air dans la partie occidentale de l’ile. L’exposition individuelle à chaque polluant a été estimée à partir d’au moins 16 mesures journalières effectuées au sein d’une surface estimée à 50x50 mètres. Les données ont été traitées à l’aide du modèle des risques proportionnels Cox avec ajustements multiples prenant en compte l’ âge, le sexe, le statut socioéconomique, les comorbidités (HTA, diabète, AVC, démence) ou encore l’environnement (urbain versus rural).
La cohorte plus que conséquente compte 5 113 322 participants (âge moyen 50,1 ± 6,9 ans ; hommes : 47,3 %) indemnes de toute maladie neurodégénérative à l’état basal. Au terme d’un suivi moyen de 11,2 ± 2,4 années, ont été dénombrés 20 694 cas de maladie de Parkinson. Dans un modèle à polluant unique, certaines substances ont été associées à un risque accru de maladie de Parkinson : c’est le cas notamment des PM2.5 (hazard ratio HR 2,65 [IC 95% 2,59 à 2,72]), des PM10 (HR 3,13 [3,04 à 3,22]), du NO2 (HR 1,74 [1,68 à 1,80]) et du SO2 (HR 1,68 [1,65 à 1,71]). Ces associations positives sont restées robustes dans le modèle multipolluants. Le cas de l’ozone est à part : l’association entre exposition et risque de maladie de Parkinson ne devient significatif qu’après ajustement selon les autres polluants, le HR étant alors estimé à 1,29 (1,25–1,33).
Cette étude rétrospective avec données de suivi à long terme plaide en faveur d’un lien entre pollution atmosphérique et risque de maladie de Parkinson. Le modèle dit multipolluants est particulièrement éloquent et certains polluants semblent plus neurotoxiques que d’autres. Des résultats à interpréter avec prudence, compte tenu des limites méthodologiques propres à ces études épidémiologiques rétrospectives qui portent certes sur des cohortes souvent conséquentes, tout en se heurtant à la multiplicité des facteurs de confusion, à l’imprécision sur l’exposition individuelle ou encore celle des critères diagnostiques (ici données administratives de codage ou de prescriptions d’antiparkinsoniens).
References
Chen SJ, Pan SC, Wu CD, et al. Long-term exposure to multiple air pollutants and risk of Parkinson's disease: a population-based multipollutant model study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2025 Jul 16;96(8):757-765. doi: 10.1136/jnnp-2024-334825.
Alzheimer : comment réagir en cas d'agressivité - Plus Magazine août 2025
Démence, Alzheimer: comment réagir en cas d’agressivité
13-08-2025, 10:26Mise à jour le: 13-08-2025, 10:29Source: Plusmagazine
Colère, crise, violence... Il arrive parfois, à un stade avancé de la maladie, qu’un proche fasse preuve d’agressivité et d’irritabilité. Un comportement qui peut provoquer la détresse chez la famille. Mais comment réagir à ce symptôme souvent difficile à surmonter?
Lorsqu’on parle de démence ou d’Alzheimer, on pense bien souvent à la perte de mémoire, principale caractéristique de la maladie. Et pourtant, derrière ce trouble qui entraîne le déclin progressif des fonctions cognitives se cache un autre symptôme parfois dur à accepter: l’agressivité. Les proches de personnes atteintes de démence en font souvent l’expérience, mais n’en parlent pas. Mais comment y faire face?
Lire aussi | Alzheimer: les signes qui doivent alerter
Agressivité d’un proche? 5 conseils
1. Ne pas prendre les choses à coeur
La première chose à retenir, c’est que ce comportement est un symptôme de la maladie. Bien qu’il désarçonne, il ne faut pas prendre les reproches personnellement. Et surtout ne pas attendre d’excuses. Ce n’est pas facile, mais cela évite de tomber dans la spirale de la colère et de la frustration. Écoutez-le, et acceptez ses sentiments et frustrations.
2. Changer de sujet de discussion
Ensuite, en cas de crise de colère, il ne faut pas s’engager pas dans une discussion. Tentez d’ignorer le comportement agressif. Le mieux est de détourner l’attention en parlant d’un sujet différent...
3. Comprendre la cause du comportement
Lorsque les choses se sont calmées, essayez de parler de ce comportement et demandez pourquoi la personne a dit ceci ou fait cela... Ne soyez pas surpris si votre partenaire n’en a aucun souvenir. Parfois, cette soudaine agressivité peut cacher un inconfort. S’il ne peut pas vous répondre, essayez d’observer le comportement de votre proche et tentez de comprendre ses besoins (se soulager, boire, s’alimenter, se reposer...) et de vérifier s’ils sont satisfaits.
4. Occuper et divertir le malade
Organisez régulièrement une activité à laquelle la personne atteinte de démence peut participer. Une excursion dans un endroit qu’elle connaît bien, la préparation d’une fête de famille, une fête des grands-parents à l’école... Faites-la également participer à des activités qui la concernent directement, par exemple vider la maison. Le fait d’être actif permet de réduire le sentiment d’impuissance.
5. Demander de l’aide
Si le comportement désinhibé persiste plus longtemps que de coutume, prévenez le médecin. Ne restez pas seul, cherchez un soutien.
article Journal International de la Médecine - 6 février 2025
Alzheimer : la piste virale se renforce
Pr Audrey Rousseau | 06 Février 2025
Une étude renforce l’hypothèse d’un rôle du virus HSV-1 dans la maladie d’Alzheimer. La détection de protéines virales dans le cerveau des patients, en interaction avec la protéine tau, suggère un mécanisme initialement protecteur qui, à terme, pourrait favoriser la neurodégénérescence. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques.
La maladie d’Alzheimer (MA) est caractérisée par l’accumulation dans le cerveau de dégénérescences neurofibrillaires, constituées majoritairement de protéine tau phosphorylée (p-tau), et de plaques amyloïdes, elles-mêmes principalement constituées de protéine amyloïde ß (Aß). La cause de la MA reste inconnue, même si un lien avec des agents pathogènes est régulièrement évoqué.
L’hypothèse HSV1 dans la maladie d’Alzheimer
Des études ont montré que la réponse immunitaire du cerveau face à des agents pathogènes pourrait favoriser le développement de la MA. Il existerait notamment un lien entre MA et encéphalite virale, le virus HSV1 (virus herpes simplex de type 1) étant le principal candidat. En effet, les individus ayant survécu à une encéphalite herpétique présentent un risque plus élevé de développer des troubles cognitifs et une démence. De plus, l’infection par HSV1 a été associée à une production de protéine Aß et de p-tau par des neurones adjacents aux neurones infectés par le virus.
L’ADN du virus peut persister des années après une infection tandis que les protéines du virus ont des demi-vies de quelques heures. Hyde et al. ont détecté des niveaux très faibles de protéines HSV1 à l’aide de techniques particulièrement sensibles dans des cerveaux de patients atteints de MA plus ou moins avancée. Le but était d’évaluer le rôle de cette production a minima de protéines HSV1 dans la physiopathogénie de la maladie.
Co-localisation de protéines virales et de tau phosphorylée
Les protéines HSV1 étaient détectées tout au long de la MA. A partir d’échantillons et d’organoïdes de cerveaux humains, les auteurs ont observé une co-localisation de tau et des protéines du virus. Dans les régions du cerveau renfermant des dégénérescences neurofibrillaires et des dépôts amyloïdes, l’expression d’ICP27 - une protéine précoce/intermédiaire de l’infection par HSV1 - augmentait avec la sévérité de la MA.
La protéine ICP27 co-localisait avec p-tau, mais pas avec Aß, et cette co-localisation était d’autant plus marquée que la MA était avancée. La p-tau co-localisait également avec les cellules microgliales (macrophages résidents du système nerveux central).
La protéine tau phosphorylée, un rempart contre HSV1 ?
L’infection par HSV1 induisait une phosphorylation de tau dans des neurones humains en culture en 2 dimensions (2D) ou 3D (organoïdes). La phosphorylation de tau inhibait l’expression d’ICP27 et était associée à une réduction significative de la mort neuronale (de 64 % à 7 % dans les organoïdes) après infection par HSV1. La p-tau jouait ainsi un rôle protecteur vis-à-vis des neurones.
Le virus HSV1 et d’autres virus à ADN sont reconnus par cGAS (cGAMP synthase), qui détecte l’ADN viral présent dans le cytoplasme et active la voie cGAS-STING, entraînant la libération de cytokines antivirales pro-inflammatoires et d’interférons. Cette voie cGAS/STING semble activée dans les maladies neurodégénératives et est une cible thérapeutique potentielle dans la MA.
Les auteurs ont visualisé les produits de la voie cGAS/STING, NFKB et IRF3. Ces derniers co-localisaient avec ICP27 et p-tau dans les MA avancées. L’activation de la voie cGAS/STING entraînait une expression et une phosphorylation de tau. L’activation de cette voie activait le facteur TBK1 qui recrute et phosphoryle NFKB et IRF3. Une inhibition de TBK1 prévenait la phosphorylation de tau.
Au total, p-tau inhibait l’expression des protéines HSV1 indiquant un potentiel rôle antagoniste vis-à-vis du virus. L’activation de la voie cGAS-STING augmentait la phosphorylation de tau tandis que l’inhibition de TBK1 la prévenait. Ces résultats suggèrent que la phosphorylation de tau agit comme une réponse immunitaire innée régulée par cGAS-STING dans la MA.
Cette étude plaide en faveur du rôle au moins facilitateur des infections virales dans les maladies neurodégénératives. Tau pourrait jouer un rôle protecteur initial mais entraîner, en cas de réponses prolongées ou dérégulées, des pathologies du système nerveux central.
Article du JIM du 6 décembre 2024
DT2 : le sémaglutide pourrait-il retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer ?
Dr Philippe Tellier | 06 Décembre 2024
Parmi les problèmes majeurs qui mettent à rude épreuve la santé publique, figure en bonne place l’augmentation de la prévalence des maladies neurodégénératives, parallèlement au vieillissement inexorable de la population mondiale. C’est ainsi qu’en 2024, aux Etats-Unis, le nombre de cas de maladie d’Alzheimer s’élèvera à 6,9 millions pour atteindre, selon les projections les plus récentes, 13,8 millions en … 2060.
En l’absence de traitement curatif, il est clair que la prévention de cette dernière est la seule option efficace, d’autant que près d’une fois sur deux, certaines maladies neurodégénératives (dont la maladie d’Alzheimer) sont sinon provoquées, du moins favorisées par des facteurs de risque totalement modifiables.
Le sémaglutide qui appartient à la classe pharmacologique des agonistes du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) est indiqué, aux Etats-Unis, dans le traitement du diabète de type 2 depuis 2017 et, depuis 2021, de l’obésité.
Son efficacité ne se limite pas à la perte de poids et à l’amélioration du contrôle glycémique. En effet, les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables s’en ressentent, que ce tabagisme, la consommation d’alcool, les troubles dépressifs etc. De ce fait, le sémaglutide pourrait-il prévenir l’apparition de la maladie d’Alzheimer chez des patients à haut risque ? Cette hypothèse est à l’origine d’une série de simulations d’essais randomisés cibles, basée sur des données recueillies dans le monde réel.
Sept émulations d’essais cibles : plus d’un million de patients diabétiques, un « suivi » de trois ans
L’exercice a consisté à utiliser de manière rétrospective les dossiers médicaux électroniques de 116 millions de patients résidant aux Etats-Unis. Cette masse de données a permis d’alimenter sept emulation target trials qui sont autant d’émulations d’essais cibles, qui permettent de se rapprocher des résultats d’un essai randomisé à partir de données observationnelles.
Ont été in fine inclus 1 094 761 patients atteints d'un diabète de type 2, indemnes de maladie d’Alzheimer initialement. Le sémaglutide a été ainsi comparé à 7 traitements antidiabétiques. L’apparition de cette maladie neurodégénérative a été dénombrée au terme d’un suivi de trois années après l’inclusion. Les données comparatives ont été traitées au moyen du modèle des risques proportionnels de Cox et de l’analyse des courbes de survie de Kaplan-Meier.
Le sémaglutide associé à une diminution du risque de maladie d’Alzheimer comprise entre 40 % et 70 %
Il s’avère que le sémaglutide a été associé à une diminution du risque de maladie d’Alzheimer, comparativement aux autres stratégies thérapeutiques. C’est par rapport à l’insuline que le bénéfice semble le plus évident, le hazard ratio [HR] correspondant étant de fait évalué à 0,33 [IC 95 % 0,21 à 0,51]. Il est moindre, quoique significatif, quand la comparaison porte sur les autres agonistes du GLP-1, le HR étant alors estimé à 0,59 [0,37 à 0,95].
Il est intermédiaire si l’on se réfère aux autres classes pharmacologiques couramment utilisées dans le traitement du diabète de type 2, qu’il s’agisse des sulfonylurées, de la metformine, des inhibiteurs de la DDP-4 (dipeptidyl-peptidase-4) ou du SGLT2 (sodium-glucose cotransporter-2), des thiazolidinediones ou de divers agonistes du GLP-1 (albiglutide, dulaglutide, exenatide, liraglutide, lixisenatide pour la plupart commercialisés uniquement aux Etats-Unis). Ces résultats ont été retrouvés dans divers sous-groupes constitués en fonction de l’obésité, du genre ou encore de l’âge.
Les limites de toute étude rétrospective…
Il ressort de cette série d’émulations d’essais randomisés que le sémaglutide serait à même de réduire le risque de maladie d’Alzheimer de 40 à 70 % chez des patients à haut risque, en l’occurrence atteints d’un diabète de type 2. C’est par rapport aux autres médicaments antidiabétiques que cette évaluation a été réalisée. L’émulation d’essai randomisé cible est une technique peu coûteuse qui consiste à appliquer au mieux les principes de l’essai randomisé à des données d’observation traitées de manière rétrospective.
Elle permet de s’affranchir des exigences propres à ce gold standard qu’est l’essai randomisé, notamment sous l’angle des coûts, des considérations éthiques ou encore du suivi à très long terme qui s’impose face à des maladies chroniques d’évolution lente. Il va sans dire que ces simulations ne peuvent que susciter des hypothèses du fait de leurs biais rétrospectifs potentiels et des limites des méthodes utilisées pour limiter leur poids.
Les promesses du sémaglutide exigent une confirmation qui passe nécessairement par le recours aux essais randomisés classiques, ces derniers restant la clé de tout progrès thérapeutique décisif et le pivot de toute validation externe digne de ce nom.
References
Wang W, Wang Q, Qi X, et al. Associations of semaglutide with first-time diagnosis of Alzheimer's disease in patients with type 2 diabetes: Target trial emulation using nationwide real-world data in the US. Alzheimers Dement. 2024 Oct 24. doi: 10.1002/alz.14313.
Article du JIM du 20 septembre 24 - Alzheimer
La pollution lumineuse, possible facteur de risque de maladie d’Alzheimer
Dr Roseline Peluchon | 20 Septembre 2024
De nombreuses communes françaises luttent désormais contre la pollution lumineuse. Elles avancent des arguments économiques, écologiques, mais elles peuvent aussi se prévaloir d’objectifs de santé publique. Car les études ont montré que la pollution lumineuse peut avoir des effets négatifs sur la santé, et serait en lien avec des troubles du sommeil, l’anxiété, ou encore des troubles dépressifs. Une nouvelle étude récemment publiée a, quant à elle, étudié le lien entre la pollution lumineuse et la maladie d’Alzheimer.
L’étude a comparé les expositions à différentes intensités lumineuses nocturnes et la survenue d’une maladie d’Alzheimer. Elle est menée sur les données de 48 états américains, entre 2012 et 2018, pour lesquels l’intensité lumineuse nocturne moyenne était répertoriée, ainsi que sur la prévalence de la maladie d’Alzheimer, fournie par Medicare.
Une étude dans les 48 états américains
L’analyse des données révèle des différences statistiquement significatives de la prévalence de la maladie d’Alzheimer selon les différents états, les états ayant l’intensité lumineuse la plus élevée pendant la nuit étant ceux où la prévalence de la maladie d’Alzheimer est aussi la plus élevée. Le lien est présent pour l’ensemble de la période considérée, et pour chaque année examinée séparément, et quel que soit l’âge des personnes, le sexe, et l’origine ethnique. Il est retrouvé tant au niveau des états que des comtés.
Un facteur comme d’autres ?
Les auteurs notent que l’intensité lumineuse nocturne moyenne présente un lien plus fort avec la maladie d’Alzheimer que ce qui est constaté pour d’autres facteurs de risque, comme l’abus d’alcool, l’insuffisance rénale chronique, la dépression, l’insuffisance cardiaque ou l’obésité. Cependant, d'autres covariables étaient plus fortement associées à la maladie d'Alzheimer que l'intensité lumineuse, notamment la fibrillation auriculaire, le diabète, l'hyperlipidémie, l'hypertension et l'accident vasculaire cérébral.
Cependant, pour les personnes de moins de 65 ans, l'intensité lumineuse moyenne était associée à la prévalence de la MA même en prenant en compte toutes les covariables suggérant que ces personnes pourraient être particulièrement sensibles aux effets de l’exposition à la lumière la nuit.
La pollution lumineuse pourrait donc être impliquée dans le développement ou la progression de la démence et des maladies neurodégénératives, autant que d’autres facteurs suspectés, comme l’allongement de la durée de vie, l’émergence de pathologies liées au mode de vie comme l’obésité, le diabète et de nombreux facteurs environnementaux relatifs à l’urbanisation et l’industrialisation.
Plusieurs explications sont évoquées par les auteurs. La relation pourrait être établie par l’intermédiaire de perturbations du rythme circadien en lien avec la pollution lumineuse. Il pourrait s’agir aussi d’un phénomène biochimique de sécrétion d’une cytokine pro-inflammatoire : il a été démontré que l’exposition de souris à un excès de lumière est à l’origine de la production d’interleukine 1β (IL-1β), elle-même associée à la maladie d’Alzheimer.
References
Voigt RM, Ouyang B, Keshavarzian A. Outdoor Nighttime Light Exposure (Light Pollution) is Associated with Alzheimer's Disease. medRxiv [Preprint]. 2024 Feb 15:2024.02.14.24302831. doi: 10.1101/2024.02.14.24302831.
Dans le Journal International de Médecine du 7 octobre 2024
DT2 : les ISGLT2 diminuent-ils le risque de démence et de maladie de Parkinson ?
Dr Philippe Tellier | 08 Octobre 2024
La prévalence et l’incidence des maladies neurodégénératives, qu’il s’agisse de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer, ou de la démence vasculaire, sont en progression constante à l’échelon mondial, du fait du vieillissement inexorable de sa population. Le diabète de type 2 constitue un facteur de risque impliqué dans le fléchissement cognitif ou encore l’aggravation des symptômes de la plupart des maladies neurodégénératives précédemment évoquées, tout particulièrement chez le sujet âgé.
Des stratégies préventives efficaces doivent être instaurées rapidement dans un tel contexte, et la place de la pharmacothérapie mérite d’être évoquée, d’autant que l’insulinorésistance et la diminution du métabolisme cérébral du glucose pourraient avoir en commun certains mécanismes pathogéniques.
A cet égard, les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose, connus sous l’acronyme iSGLT2 seraient-ils doués d’effets pléiotropes, à l’instar d’autres classes pharmacologiques (telles celle des statines à leurs débuts) ? La question peut se poser à la lecture de certaines études qui leur attribuent, outre un effet cardio- et néphro-protecteur, des vertus protectrices qui s’étendraient à d’autres organes que le cœur et le rein… en l’occurrence le cerveau.
L’amélioration de la fonction mitochondriale et de l’autophagie, par le biais des lysosomes, ainsi que l’augmentation de la cétogenèse seraient-elles bénéfiques au niveau cérébral au point d’intervenir dans la pathogénie des maladies neurodégénératives, de retarder leur apparition ou de diminuer leur expression symptomatique ? La correction des facteurs de risque cardiovasculaire sous l’effet des iSGLT2 entre-t-elle en ligne de compte ?
Une étude rétrospective sud-coréenne : près de 360 000 participants
Autant de questions auxquelles une étude de cohorte rétrospective sud-coréenne apporte des éléments de réponse. Ont été initialement inclus 1 348 362 participants, tous atteints d’un diabète de type 2 et âgés d’au moins 40 ans. Les données ont été recueillies auprès de l’Assurance maladie du pays. Un traitement antidiabétique a été débuté entre 2014 et 2019 et deux groupes ont été constitués, avec appariement selon la méthode du score de propension.
Le groupe d’intérêt a été constitué de patients qui ont bénéficié d’une prescription d’un iSGLT2, d’autres antidiabétiques oraux ayant été administrés dans le groupe témoin. In fine, l’analyse a porté sur une cohorte de 358 862 participants (âge moyen 57,8±9,6 ans ; hommes : 58,0 %). Les critères de jugement primaire ont été définis par l’incidence de chacune des maladies neurodégénératives suivantes : maladie d’Alzheimer, démence vasculaire et maladie de Parkinson.
Les critères secondaires, pour leur part, ont porté sur toutes les démences, quelle que soit leur cause, et la combinaison des trois pathologies neurodégénératives précédentes. Les données ont été traitées à l’aide du modèle des risques proportionnels de Cox.
Moins de démences dans le groupe exposé aux iSGLT2
Au total, 6 837 évènements imputables à des états démentiels ont été enregistrés au cours du suivi. Pour ce qui est des critères primaires, l’exposition aux i SGLT2 a été associée à une diminution modeste du risque de maladie d’Alzheimer, le hazard ratio ajusté (HRa) correspondant étant de fait estimé à 0,81 [IC 95% 0,76–0,87]. Il en a été de même pour le risque de démence vasculaire (HRa=0,69 [0,60–0,78]) ou encore de maladie de Parkinson (HRa=0,80 [0,69–0,91]).
Pour les démences toutes causes confondues, le HRa a été estimé à 0,79 [0,69–0,90], l’adjonction de la maladie de Parkinson ne changeant guère ce résultat (HRa=0,78 [0,73–0,83]). Ces associations n’ont pas été affectées par la prise en compte du sexe, de l’index de comorbidité de Charlson, des complications du diabète, des comorbidités ou encore des divers traitements. Les analyses de sensibilité avec ajustements selon diverses variables biocliniques (pression artérielle, glycémie, profil lipidiques, fonction rénale) ont abouti à des résultats reproductibles.
Cette étude rétrospective sud-coréenne, du type cas-témoins, plaide en faveur d’associations significatives entre l’exposition aux iSGLT2 et le risque de maladies neurodégénératives. Cette classe pharmacologique aurait-elle le don de prévenir ces dernières ou de retarder leur expression symptomatique ? D’autres études de cohorte de préférence prospectives sont nécessaires pour confirmer ces résultats et rechercher un éventuel lien de causalité.
References
Kim HK, Biessels GJ, Yu MH, et al. SGLT2 Inhibitor Use and Risk of Dementia and Parkinson Disease Among Patients With Type 2 Diabetes. Neurology. 2024 Oct 22;103(8):e209805. doi: 10.1212/WNL.0000000000209805.
Date de dernière mise à jour : 20/09/2025
Ajouter un commentaire