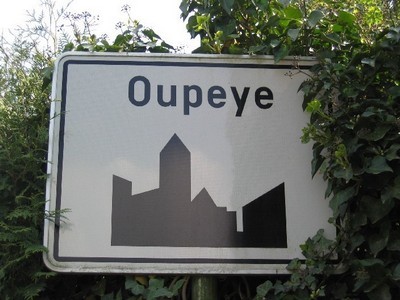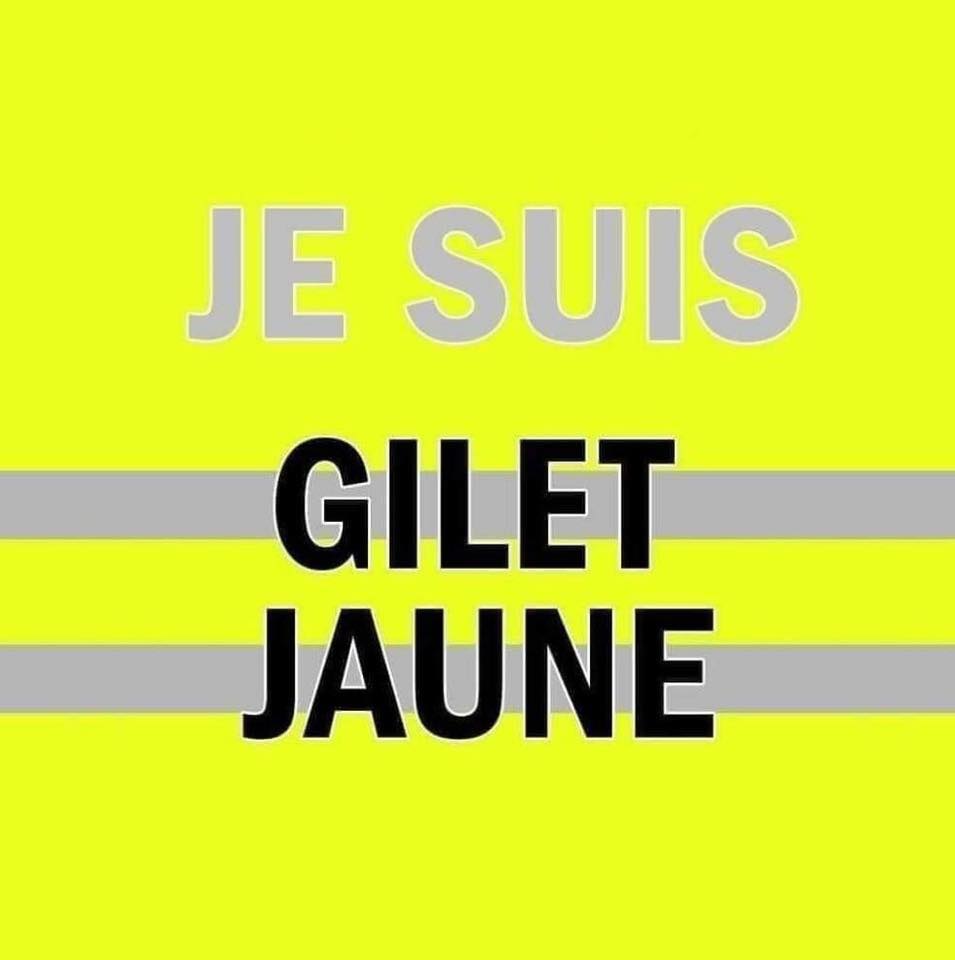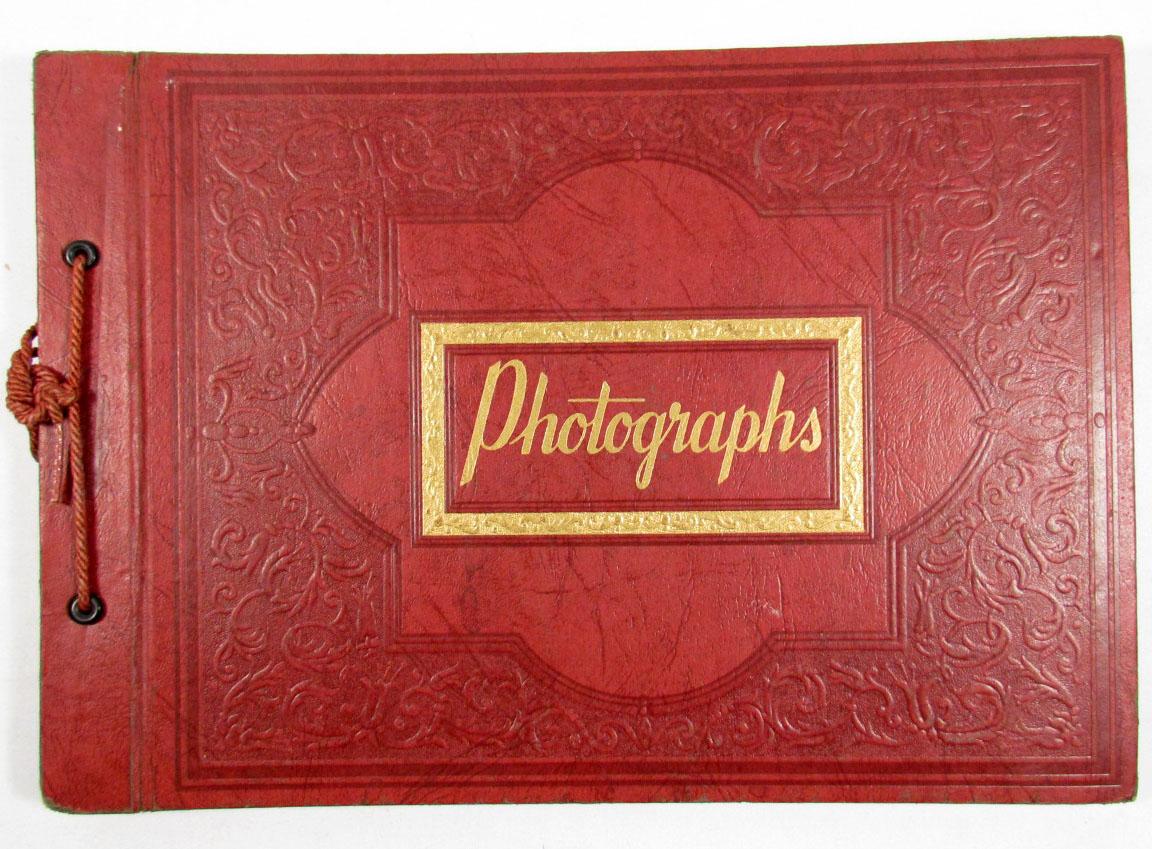A quoi sert l'intelligence
Du journal International de Médecine du 6 juin 2025
A quoi sert l’intelligence ?
Aurélie Haroche | 06 Juin 2025
Paris – Quotidiennement, la stupéfaction nous étreint. Un être dont l’intelligence apparaît établie, compte tenu de son parcours universitaire, de ses travaux, de la teneur de ses discours, prend une décision manifestement imbécile ou choisit de défendre une thèse incontestablement grotesque.
S’il peut reconnaître rapidement son erreur, il peut également s’y enferrer avec la plus grande conviction et parfois même une certaine hargne. La consternation des pairs, la désapprobation quasi générale, voire-même les sanctions n’y font parfois rien et ce d’autant plus si une troupe d’admirateurs vient masquer la dissonance cognitive.
Des exemples qui foisonnent
Sans parler d’un grand nombre de représentants politiques qui continuent à nous surprendre en nous confirmant quasi quotidiennement que la raison n’est pas toujours l’apanage de ceux qui ont pourtant parallèlement une maîtrise de nombreux domaines intellectuels, les communautés médicales et scientifiques regorgent d’exemple.
On a vu ainsi si souvent (trop souvent) des illustres praticiens accréditer les théories les plus assassines concernant la dangerosité des vaccins. D’autres défendre envers et contre tout l’efficacité de traitements inefficaces ou des derniers encore réfuter certains principes pourtant plus qu’éprouvés.
Oserons-nous citer ceux qui récemment ont le plus largement occupé ce terrain ou préférerons-nous ne pas rappeler à nos souvenirs l’image d’un Prix Nobel de Médecine, d’un infectiologue phocéen ou encore d’un chercheur en géologie (qui aura cumulé science et politique) ?
Ou nous contenterons nous de penser à tous ceux qui après des études scientifiques rigoureuses se tournent vers l’homéopathie, le reiki et autres-pseudo médécines ?
Rétablir la cohérence du monde
Face à ces intelligences prises en défaut, les interrogations sont nombreuses. Faut-il dès lors considérer que le diagnostic initial concernant ces sujets était erroné, que leur intelligence a été mal évaluée ? C’est parfois ce qui est tenté quand les travaux passés de ces scientifiques pris en défaut sont analysés, réévalués à travers le filtre de leurs divagations.
Par exemple, beaucoup ont voulu rappeler qu’un certain chercheur à l’Institut Pasteur avait été considérablement secondé dans ses travaux ayant consisté à identifier le VIH. D’autres ont noté que les irrégularités étaient légions dans les études qui ont fait la renommée du chantre de l’hydroxychloroquine.
L’objectif semble ici double. D’abord, inviter à se défier de l’argument d’autorité. Tout auréolé de ses titres, aussi performant soit-il à la course à la gloire, un chercheur peut en réalité avoir d’importantes limites d’un point de vue strictement scientifique. Mais il s’agit également de se rassurer en cherchant à rétablir la cohérence.
Non, on ne peut pas être intelligent et défendre les plus grandes âneries et si vous vous enferrez c’est probablement que votre intelligence n’est pas si grande.
Un monde bien rangé (ou presque)
La démonstration est séduisante, surtout qu’elle permet également de flirter avec le mythe du génie incompris, dont le corollaire inverse est celui du génie immérité. Le monde serait plein de ces spécialistes ignorés, dont le seul tort serait de ne pas avoir pu s’intégrer dans le système scolaire ou institutionnel, quand on voit partout des personnes incompétentes se hisser indument aux plus hautes sphères.
Bien sûr, la contemplation de notre personnel politique ne peut (parfois) que nous conforter dans cette thèse. Cependant, dans les faits, le monde apparaît tristement bien rangé. Les études réalisées sur le QI et les aptitudes sociales et scolaires semblent en effet confirmer que ceux dont les scores sont les plus élevés sont également ceux qui obtiennent les plus grandes réussites scolaires puis professionnelles.
Ceci ne veut évidemment pas dire que toutes les personnes intelligentes obtiennent toujours les meilleures places, ni qu’on ne compte pas des imbéciles heureux bien situés, mais cela permet néanmoins de considérablement nuancer l’idée qu’il ne faut pas présumer de l’intelligence de quelqu’un en se fondant sur sa « réussite » intellectuelle et institutionnelle. Ce n’est sans doute pas un indice suffisant, mais il peut néanmoins être considéré comme probant.
Intelligence sans raison et raison sans intelligence ?
Si l’on oublie que nos intelligences et nos vies ne sont certainement pas des fils cohérents et qu’il est plus qu’humain et naturel qu’elles présentent des variations, qui se manifestent parfois par une croyance tenance en la biodynamie (malgré notre aptitude parfaite à comprendre les calculs quantiques les plus complexes), ces observations pourraient également nous conduire vers l’idée qu’intelligence et raison ne sont pas forcément liées.
Le directeur de recherche en sciences cognitives au CNRS Franck Ramus nous rappelait il y a quelques semaines dans l’Express que cette théorie a nourri de nombreuses réflexions.
« Depuis trente ans, d’éminents chercheurs en psychologie ont théorisé l’idée selon laquelle la rationalité est une qualité indépendante de l’intelligence générale et mal mesurée par les tests usuels. Le Prix Nobel d’économie Daniel Kahneman, récemment disparu, a bâti sa carrière sur la mise en évidence des biais cognitifs affectant le raisonnement humain. Il a proposé que nous raisonnions à l’aide de deux systèmes cognitifs indépendants. Le système 1, qui produit des réponses intuitives, rapides et adaptées à l’environnement dans lequel nos ancêtres ont évolué. Et le système 2, plus lent et laborieux, qui nous permet de prendre en compte des informations multiples et complexes et de faire des raisonnements plus élaborés et nuancés. Le système 1 produisant souvent des réponses erronées aux problèmes nouveaux et difficiles auxquels le monde moderne nous confronte, la rationalité dépendrait de notre capacité à l’inhiber et à utiliser à bon escient le système 2 ».
Et revoilà la génétique
Découlant de cette thèse, les tests habituels destinés à évaluer l’intelligence ont été considérés comme impropres à mesurer la « rationalité cognitive ».
De nouveaux outils ont été développés. Las, « de nombreuses études ont trouvé que les scores de rationalité ainsi mesurée étaient particulièrement corrélés aux capacités cognitives. Une méta-analyse de 44 études a établi que les tests usuels d’intelligence prédisaient jusqu’à 70 % des différences individuelles de rationalité cognitive. De plus, une étude basée sur des paires de jumeaux suggère que le lien entre intelligence générale et rationalité cognitive est dû principalement à des facteurs génétiques communs » détaille France Ramus.
Bref, il ne semble pas que la rationalité cognitive puisse être décorrélée de l’intelligence, laissant donc toute la place à la possibilité pour des gens « intelligents » d’être bêtes, ou en tout cas de défendre des idées totalement irrationnelles.
Douter, douter, il en restera toujours quelque chose
Comment se prémunir d’une telle dérive ? Sans doute probablement tout d’abord en étant conscient que l’on ne s’en prémunit jamais, car aussi intelligent soit-il l’homme aura toujours besoin ou envie de se fier à certaines croyances (même si sa « raison » peut au moins lui permettre d’en reconnaître les absences de fondement). Sans doute aussi en pratiquant le doute systématique et d’abord sur sa propre intelligence.
Enfin, en se rappelant que l’intelligence ne suffit pas à comprendre et connaître la démarche scientifique et l’esprit critique qui continuent à devoir être enseignés sans relâche aux plus jeunes, aux plus intelligents (apparemment) et aux moins intelligents (apparemment), comme le préconise Franck Ramus et tant d’autres. Pas si bête. (Et rassurons-nous l’intelligence artificielle peut être tout autant irrationnelle que l’humaine).
Date de dernière mise à jour : 16/08/2025
Ajouter un commentaire