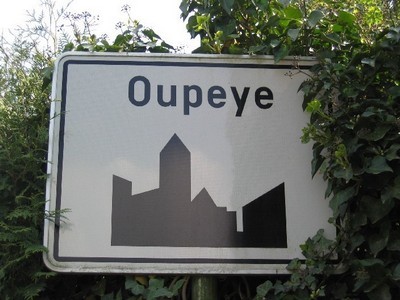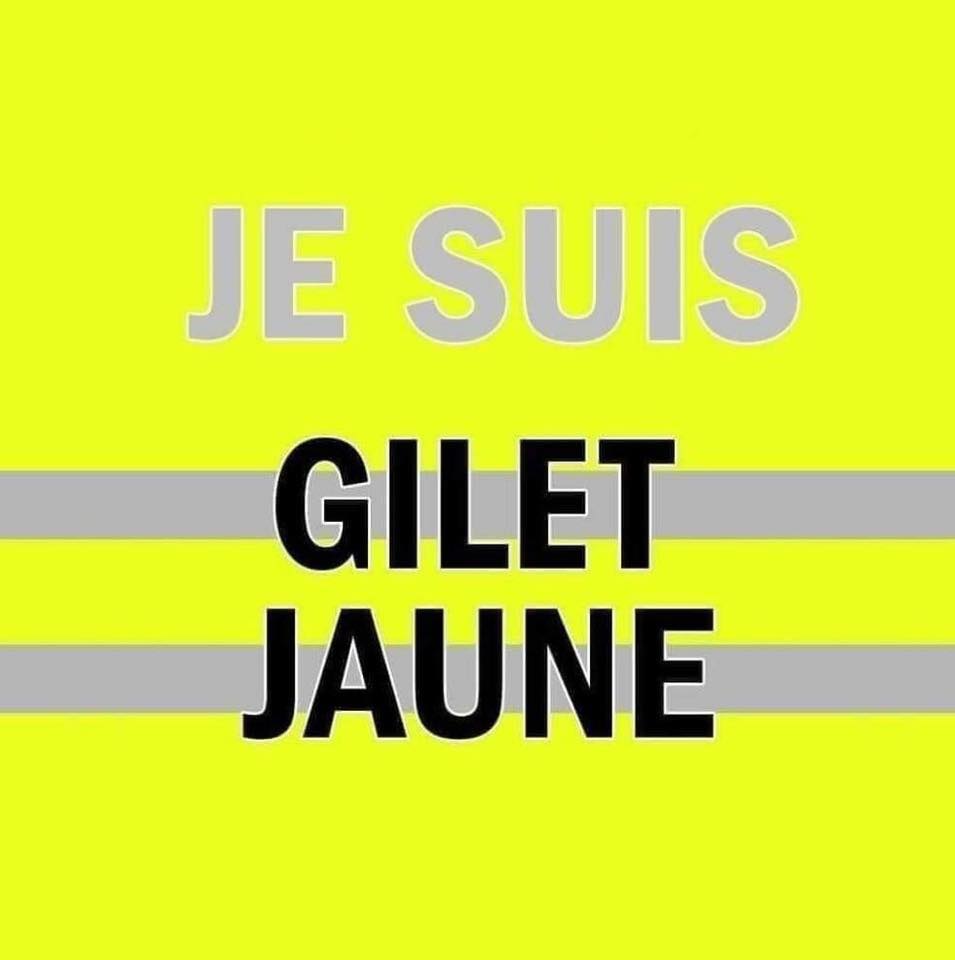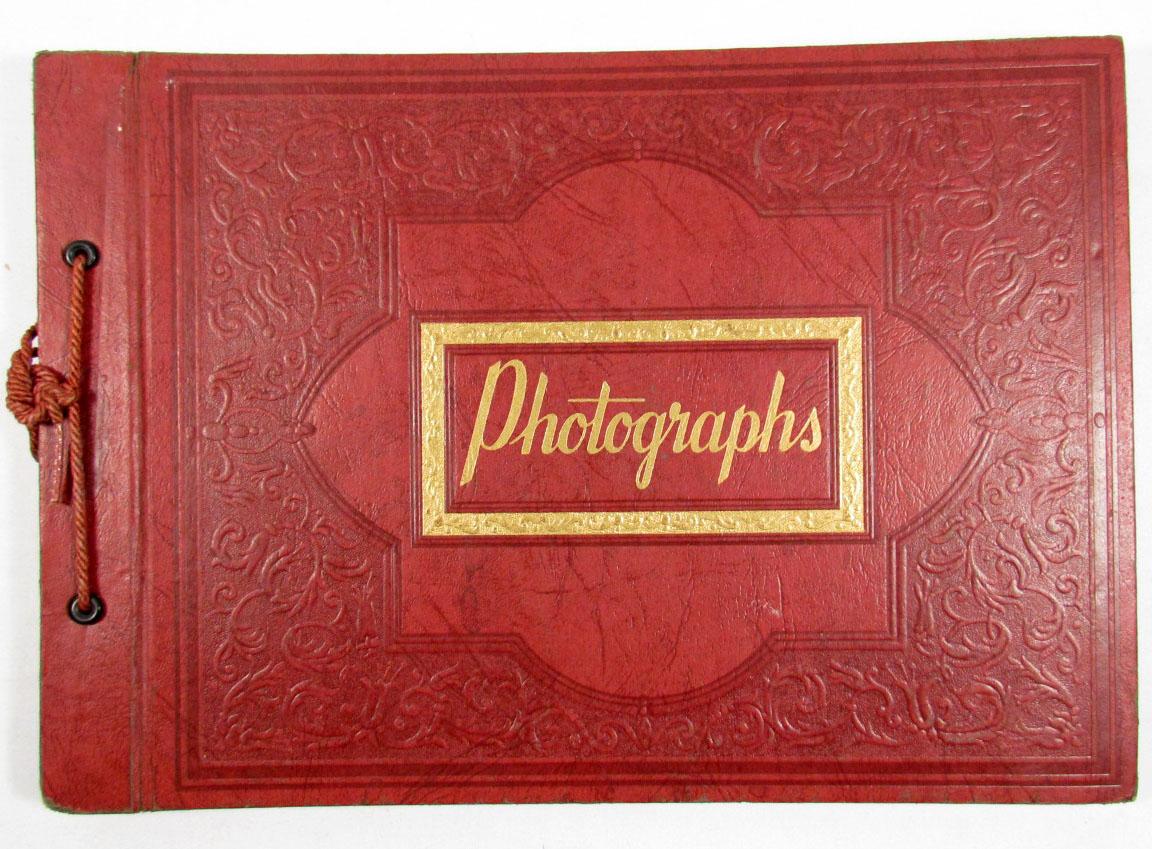Les risques des tatouages.
Article de Journal International de Médecine du mars
Les tatouages : une encre pas très sympathique
Dr Roseline Peluchon | 10 Mars 2025
Au cours des dernières années, les tatouages ont gagné en popularité, concernant jusqu’à 20 à 25 % de la population dans certains pays, et même 2 fois plus chez les jeunes générations. Cette popularité croissante des tatouages soulève toutefois des questions concernant leur sécurité et leur impact sur la santé à long terme.
Jusqu’à présent, seulement 3 études ont cherché à identifier un lien potentiel entre l’encre de tatouage et un risque accru de cancer, particulièrement le lymphome, le myélome multiple et le carcinome basocellulaire. Les études rencontrent des difficultés méthodologiques, notamment du fait des très nombreux facteurs confondants possibles.
De la peau aux ganglions lymphatiques
Lorsqu’un tatouage est réalisé, une partie de l’encre migre de la peau vers le sang et s’accumule dans les ganglions lymphatiques régionaux. Les particules contenues dans l’encre peuvent ensuite être transportées par la circulation générale vers d’autres organes.
L’encre noire en particulier, contient du noir de carbone et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, parmi lesquels le benzo(a)pyrène, classé comme cancérogène par l’Agence internationale de recherche sur le cancer. Il est donc pertinent de s’interroger sur les conséquences néfastes des tatouages sur la peau, sur le système immunitaire et sur d’autres organes.
De plus, l’encre utilisée produit une inflammation au site d’injection, à l’origine d’une inflammation chronique qui pourrait augmenter le risque de prolifération cellulaire anormale, et notamment de cancer cutané et de lymphome.
Pour améliorer le contrôle des facteurs confondants, une équipe nordique a mené deux études sur des jumeaux, qui partagent un grand nombre de facteurs génétiques et environnementaux. La première est une étude de cohorte, sur plus de 2300 jumeaux, la seconde une étude cas-témoins menée sur 316 jumeaux.
Un risque augmenté de cancers cutanés et de lymphomes
Dans l’étude cas-témoins, l’analyse individuelle montre un sur-risque de cancer de la peau quelle que soit la surface occupée par le tatouage. En comparaison avec les personnes non tatouées, le risque de cancer cutané (de tout type à l’exception du carcinome basocellulaire) augmente de 62 % chez celles qui sont tatouées (HR 1,62 [95 % CI : 1,08 à 2,41]). Le risque paraît encore supérieur quand le tatouage dépasse la taille d’une main (HR 2,37 [1,11 à 5,06]).
Toujours dans l’étude cas-témoins, le risque de lymphome apparaît dépendant de la taille du tatouage. Il n’est pas retrouvé dans les analyses qui ne tiennent pas compte de celle-ci, en revanche, le risque augmente à partir d’une surface supérieure à la paume d’une main (HR 2,73 [1,33 à 5,60]).
Le faible nombre de cas de cancer de la vessie ou des voies urinaires n’a pas permis d’étudier le lien entre les tatouages et ces types de cancers.
Dans l’étude de cohorte, le risque de cancer de la peau (hors carcinome à cellules basales) est presque multiplié par 4 en comparaison avec l’absence de tatouage (HR 3,91 [1,42 à 10,8]). Le risque de carcinome basocellulaire est estimé à 2,83 [1,30 à 6,16]. Dans cette analyse, il n’est pas possible d’estimer les effets des tatouages sur le risque de lymphome.
Les pigments sont-ils seuls responsables ou s’agit-il d’une réaction immunitaire ?
Dans cette étude, les auteurs développent l’hypothèse que les dépôts d’encre interagissent avec les tissus avoisinants, provoquant une augmentation de la prolifération cellulaire, et augmentant ainsi le risque de cancer.
Le mécanisme implique une réponse immunologique, déjà étudiée, par exemple, dans le cas du lymphome anaplasique à grandes cellules, type rare de lymphome à cellules T, qui peut apparaître après la pose d’implants mammaires. Les auteurs remarquent que cette voie n’implique pas obligatoirement des agents spécifiques contenus dans l’encre, même si la présence de substance cancérogène ajoute une part de risque.
Ils estiment donc que les effets préventifs des restrictions européennes (REACH), interdisant l’utilisation de certains pigments et substances potentiellement cancérogènes, et destinées à réduire l'exposition à une longue liste de composés cancérogènes connus ou suspectés, pourraient être moins efficaces que prévus initialement.
Au-delà du mécanisme précis du lien potentiel entre tatouages et cancer, d’autres questions se posent et restent à clarifier, comme la sécurité des procédures laser utilisées pour « effacer » les tatouages : réduire la taille des particules d’encre augmente encore leur potentiel migratoire, et l’on peut se demander où ces particules terminent leur course.
Pour les auteurs, il est désormais nécessaire de prendre en compte et d’informer sur les risques associés à l’encre de tatouage.
References
Clemmensen SB, Mengel-From J, Kaprio J, et al. Tattoo ink exposure is associated with lymphoma and skin cancers - a Danish study of twins. BMC Public Health. 2025 Jan 15;25(1):170. doi: 10.1186/s12889-025-21413-3.
Un article du Journal International de Médecine du 4 juin 2024
Le tatouage pourrait être associé à une augmentation du risque de lymphome
Dr Roseline Peluchon | 04 Juin 2024
Le tatouage est longtemps resté une pratique limitée à certains groupes, comme les marins, la légion étrangère ou les bikers. Ce n’est plus du tout le cas actuellement : dans certains pays européens, 20 % de la population serait tatouée, et ce serait 30 % aux Etats-Unis. Le premier tatouage est souvent réalisé chez des personnes jeunes, ce qui implique une exposition à certains constituants chimiques de l’encre durant la presque totalité de la vie.
Car les encres utilisées pour les tatouages ne sont peut-être pas inoffensives. Elles sont des cocktails de pigments organiques et non organiques, associés à des précurseurs et sous-produits issus de la synthèse de ces pigments, et à des additifs. Les encres colorées peuvent contenir des amines aromatiques primaires (AAP), les encres noires des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), et des métaux comme l’arsenic, le cobalt, le plomb et le nickel sont présents dans les encres quelle que soit leur couleur. Or, plusieurs produits chimiques contenus dans les encres de tatouage sont classés comme cancérigènes par l’agence internationale de recherche sur le cancer.
Des ganglions lymphatiques pigmentés chez les personnes tatouées
Pendant le tatouage, l’encre est injectée dans le derme par les perforations répétées de la peau. Une partie de l’encre migre vers les ganglions lymphatiques locaux, à partir desquels est initiée une réponse immunitaire systémique. Il est estimé qu’après 6 semaines, 32 % du pigment injecté a ainsi migré. Des ganglions lymphatiques augmentés de volume et pigmentés ont été décrits chez des personnes tatouées depuis plusieurs dizaines d’années, avec des pigments colorés ou noirs, ainsi que des dépôts de particules métalliques.
Interpelée par l’augmentation de l’incidence des lymphomes en parallèle avec la mode des tatouages, une équipe suédoise a cherché à déterminer s’il existait un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Une étude de type cas-témoin a été menée sur tous les sujets âgés de 20 à 60 ans chez lesquels avait été diagnostiqué un lymphome malin en Suède entre 2007 et 2017, soit près de 12 000 personnes. Un questionnaire leur était adressé pour vérifier si elles étaient tatouées ou non, questionnaire auquel 54 % des personnes atteintes de lymphome ont répondu (n = 1 398) et 47 % des témoins (n = 4 193).
Un risque 21 % plus élevé
Les données montrent que la prévalence du tatouage est de 21 % parmi les personnes atteintes de lymphome, et de 18 % parmi les sujets témoins (risque ajusté 1,21 ; 95 % CI 0,99 à 1,48). Le risque est supérieur chez les personnes dont le tatouage date de moins de 2 ans au moment du diagnostic de lymphome (RRa 1,81 ; 1,03 à 3,20), puis diminue et semble à nouveau augmenter quand le tatouage date de plus de 11 ans (RRa 1,19 ; 0,94 à 1,50).
Il n’est pas mis en évidence de lien entre le risque de lymphome et la surface corporelle totale recouverte. Il n’est pas non plus mis en évidence de différence de risque selon que le tatouage est noir ou en couleur. Le traitement au laser, utilisé pour faire disparaître les tatouages semble associé à une augmentation importante du risque, mais le nombre de personnes concernées est insuffisant pour en tirer des conclusions.
Enfin, deux types de lymphomes semblent plus concernés : les lymphomes diffus à grandes cellules B (RRa 1,30 ; 0,99 à 1,71) et les lymphomes folliculaires (RRa 1,29 ; 0,92 à 1,82).
Rappelons toutefois qu’un lien de causalité ne peut être affirmé à partir d’une étude épidémiologique. D’autres travaux seront donc nécessaires et, selon les auteurs, l’accroissement de la popularité de la pratique du tatouage implique une certaine urgence.
Date de dernière mise à jour : 09/08/2025
Ajouter un commentaire