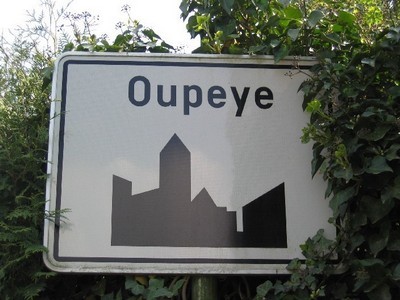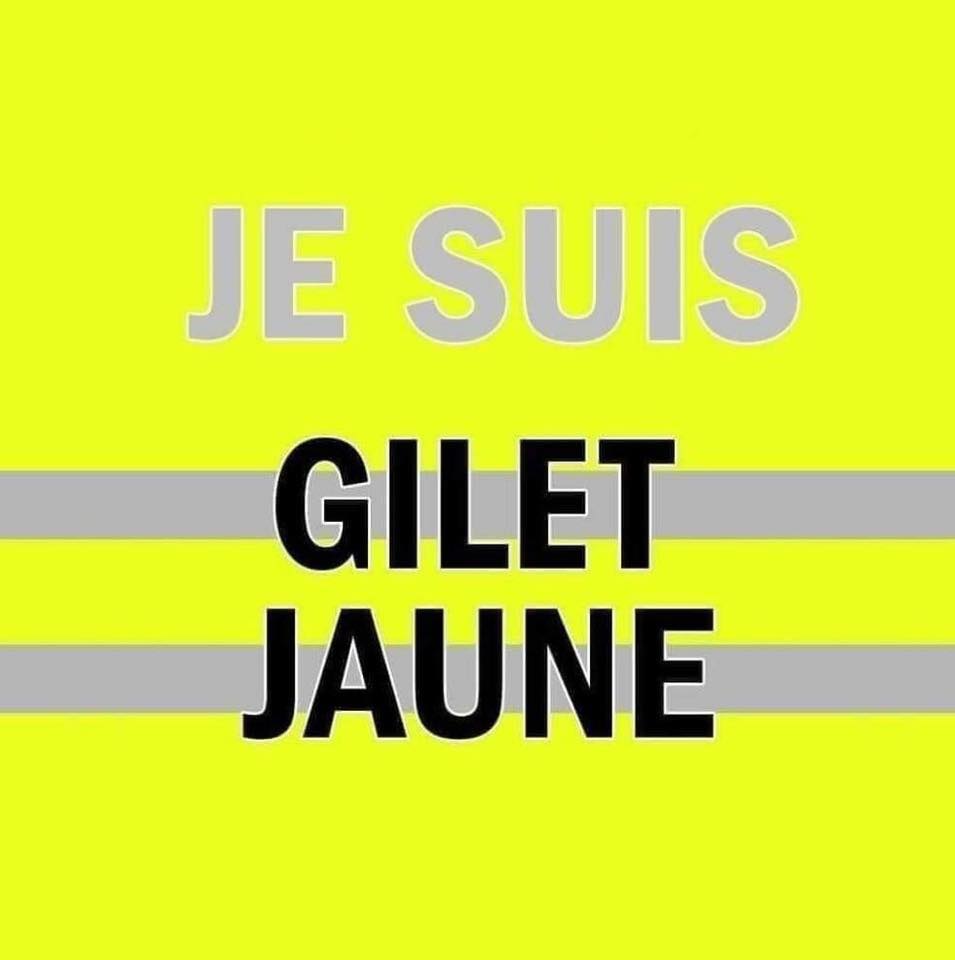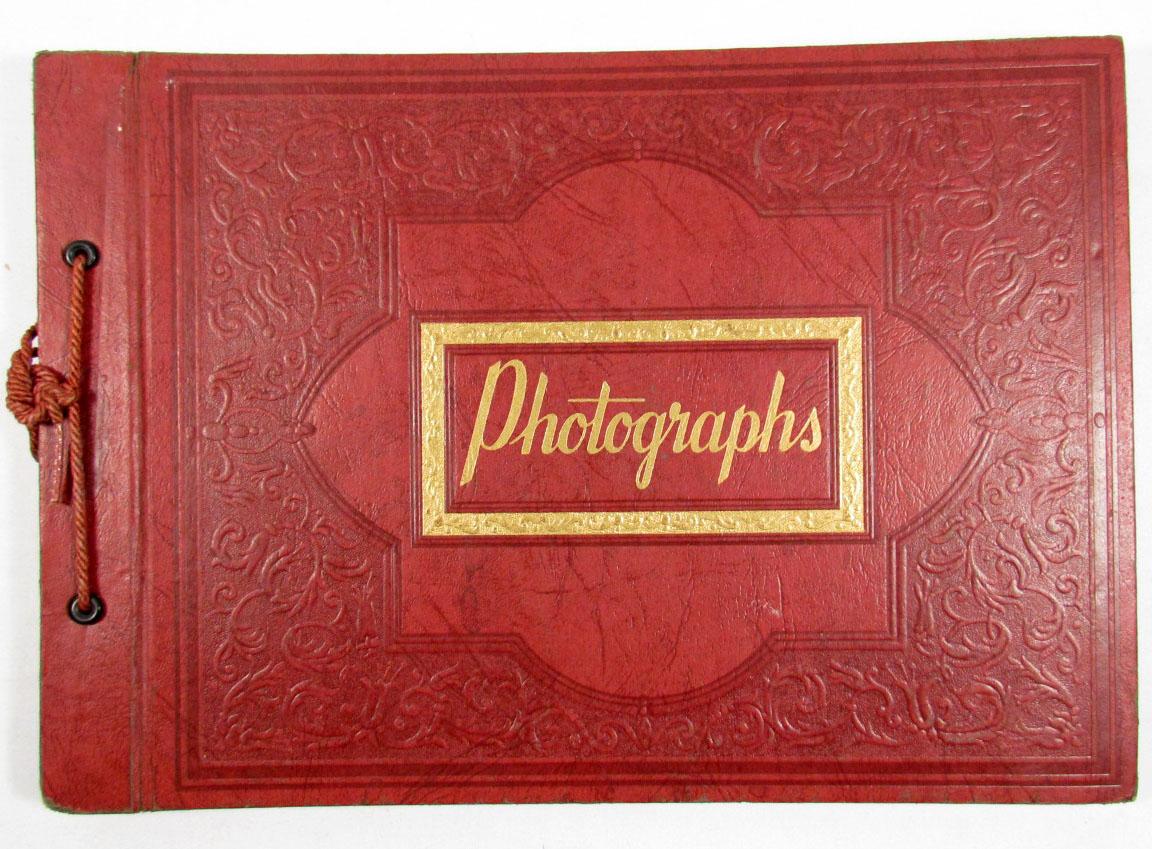Redéfinir l'obésité
Du Journal International de Médecine du 21 juillet 2025
Redéfinir l’obésité : progrès conceptuel ou impasse ?
Dr Philippe Tellier | 21 Juillet 2025
La nouvelle définition de l'obésité de l'EASO reclasse 1 Américain sur 5 en surpoids comme obèse. Paradoxe : ces nouveaux "obèses" présentent la même mortalité que les personnes de poids normal.
L'obésité est classiquement définie par un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 kg/m². Avec une telle définition, si l’on admet que la valeur de l’IMC est nécessaire et suffisante pour en faire une maladie chronique, elle touche environ deux adultes sur cinq aux États-Unis. Cette prévalence génère un lourd fardeau en termes de morbimortalité et de coûts de santé. Cependant, cette approche traditionnelle est aujourd'hui remise en question, et les avancées scientifiques des dernières décennies questionnent sa pertinence. Les progrès dans la compréhension des mécanismes pathogéniques, l'évolution des données épidémiologiques et le développement de nouvelles approches thérapeutiques convergent tous dans ce sens. De nombreux arguments plaident pour une révision de cette classification. L'IMC apparaît comme un outil trop imparfait pour évaluer à lui seul le risque individuel, cette mesure ne tenantappro compte ni de la distribution de la masse grasse, ni de la composition corporelle. Elle ignore également les comorbidités métaboliques qui peuvent moduler considérablement le pronostic. Face à ces limites, une question se pose. Faut-il changer de paradigme ? Doit-on introduire de nouveaux outils diagnostiques plus performants ? L'enjeu est de redéfinir l'obésité et de mieux stratifier les risques qu'elle représente.
Le choix de l’EASO
Au-delà de cette question, c’est le choix qui a été fait par l’EASO (European Association for the Study of Obesity ) (1) qui risque de déboucher sur une impasse pour les systèmes de santé, comme le suggèrent les résultats d’une étude transversale, publiés dansAnnals of Internal Medicine (2). Pour mémoire, l’EASO a proposé en 2025 que les personnes dont l’IMC est compris entre 25 et 30 kg/m2, qui ont un rapport tour de taille/hauteur supérieur à 0,5, ET une comorbidité liée à l'obésité, soient reclassées comme souffrant d'obésité.
Dans l’étude publiée dans Annals of Internal Medicine, des données ont été extraites de l’enquête NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) (1999–2018), afin d’évaluer les effets de la nouvelle définition (par rapport à l’ancienne basée sur l’IMC seul) quant à la prévalence de l’obésité et à la mortalité qui lui est imputable. Cette analyse est donc totalement rétrospective, bien qu’il existe des données de suivi sur la mortalité.
Mais, comment la nouvelle définition de l’obésité a-t-elle été élaborée ? Cette question pertinente met en lumière les limites de la méthodologie utilisée, en l’occurrence la méthode DELPHI. Cette approche consiste à réunir des experts internationaux de l’obésité, en l’occurrence vingt-huit, afin de mettre au point un nouvel outil intégrant l’IMC, le rapport tour de taille/hauteur et le nombre de comorbidités, ceci au terme de plusieurs sessions visant à obtenir un consensus. Cet objet clinique, non validé par la méthode expérimentale, est une construction intellectuelle et intelligible qui conduit à augmenter de manière substantielle le nombre de "persons with obesity", comme le révèlent l’analyse des données colligées dans l’enquête NHANES.
Analyse des données de l’enquête NHANES
La cohorte se compose de 44 030 Américains âgés de 18 à 79 ans. L’obésité ou le surpoids ont été définis de deux manières : (i) traditionnelle : surpoids pour un IMC de 25-29,9 kg/m2 obésité si IMC ≥ 30 kg/m2 ; (ii) outil EASO : obésité si IMC ≥ 30 kg /m2 ou IMC 25–29,9 kg/m2 + tour de taille/hauteur ≥ 0,5 + ≥1 comorbidité (hypertension artérielle, diabète, arthrose, maladie cardiovasculaire, BPCO, dépression ou maladie rénale chronique).
À cette aune, l’outil EASO conduit à reclasser parmi les obèses 18,8 % des patients considérés en surpoids d’après leur IMC seul. De facto, plus de la moitié des Américains souffrirait alors d’obésité, contre 35,4 % avec l’IMC seul.
A partir des données de l’enquête NHANES, la mortalité s’est avérée similaire chez les nouveaux obèses et chez les sujets de poids normal avec ou sans comorbidités (hazard ratio [HR], 0,98 [IC 95 %, 0,87-1,10]). La même comparaison montre une surmortalité en cas d’IMC ≥ 30 kg/m2 ( HR, 1,19 [1,08-1,32]).
Cependant, en comparant les nouveaux obèses uniquement avec les sujets de poids normal sans comorbidité majeure, une surmortalité est observée chez les nouveaux obèses (HR, 1,50 [1,20-1,88]). En cas d’IMC ≥ 30 kg/m2, la valeur correspondante du HR est de1,82 [1,46–2,27]. Le risque rejoint cependant celui des patients de poids normal avec comorbidités (HR, 1,74 [IC 95 %, 1,34-2,22]). Les comorbidités les plus fréquemment observées chez les nouveaux obèses ont été les suivantes : hypertension artérielle (79,9 %), arthrose (33,2 %), diabète (15,6 %) et maladie cardiovasculaire (10,5 %).
Une définition propice à la réflexion plus qu’à l’action
Il apparaît ainsi que la définition de EASO conduit en théorie à détecter plus tôt les patients à risque, en visant une population symptomatique mais négligée par la seule mesure de l’IMC, avec à la clé une surmortalité estiméeau à 50 %, comparativement à des témoins de poids normal avec comorbidités. L’exercice conduit surtout à reclasser près de 20 % des sujets en surpoids en leur accordant le statut d’obèse à partir de critères arbitraires, quand bien même ils émanent d’experts internationaux.
Cela étant, cette étude est rétrospective et il faut se garder de considérer les données sur la mortalité comme totalement fiables, eu égard aux nombreux facteurs de confusion potentiels, voire à un biais de causalité inverse, le poids normal pouvant refléter une pathologie associée non détectable. Cette nouvelle définition de l’obésité qui conduit à augmenter le nombre d’obèses au sein de la population générale est-elle cliniquement pertinente ? Plus de la moitié des Américains accèderaient ainsi à un statut justiciable d’un traitement à long terme, mais lequel ? Il n’existe actuellement aucune preuve du bien-fondé de cette nouvelle approche purement consensuelle, sans substrat scientifique.
À cette aune, c’est une impasse clinique qui se dessine à l’horizon, plus qu’un progrès permettant de gérer au mieux l’énorme problème de santé publique posé par l’obésité à l’échelon mondial. C’est ici que l’ombre de Claude Lévi-Strauss plane. Car le cadre défini par l’EASO, loin d’être une démonstration scientifique, ressemble à ce qu’il appelait un "bricolage" : une combinaison astucieuse d’éléments disponibles pour donner forme à une construction intelligible, mais non validée.
La nouvelle définition est scientifiquement cohérente et cliniquement séduisante. Elle n’en pose pas moins des problèmes méthodologiques, économiques et éthiques majeurs. Le risque d’inflation diagnostique sans bénéfice thérapeutique démontré est réel. Elle doit être considérée comme une base de réflexion plutôt qu’un outil opérationnel à ce stade. Des validations prospectives et des preuves d’efficacité thérapeutique sont indispensables avant d'en faire un cadre normatif valable à l’échelon international (3).
References
Busetto L, Dicker D, Frühbeck G, et al. A new framework for the diagnosis, staging and management of obesity in adults. Nat Med. 2024 Sep;30(9):2395-2399. doi: 10.1038/s41591-024-03095-3.
Dicker D, Karpati T, Promislow S, Reges O. Implications of the European Association for the Study of Obesity's New Framework Definition of Obesity: Prevalence and Association With All-Cause Mortality. Ann Intern Med. 2025 Jul 8. doi: 10.7326/ANNALS-24-02547.
Wee CC, Batch BC, Guallar E. Staging Obesity Risk Beyond Body Mass Index: Progress Made but More to Do. Ann Intern Med. 2025 Jul 8. doi: 10.7326/ANNALS-25-02327.
Date de dernière mise à jour : 22/07/2025
Ajouter un commentaire