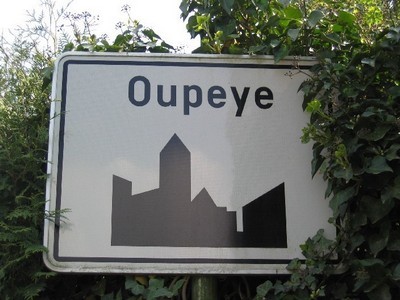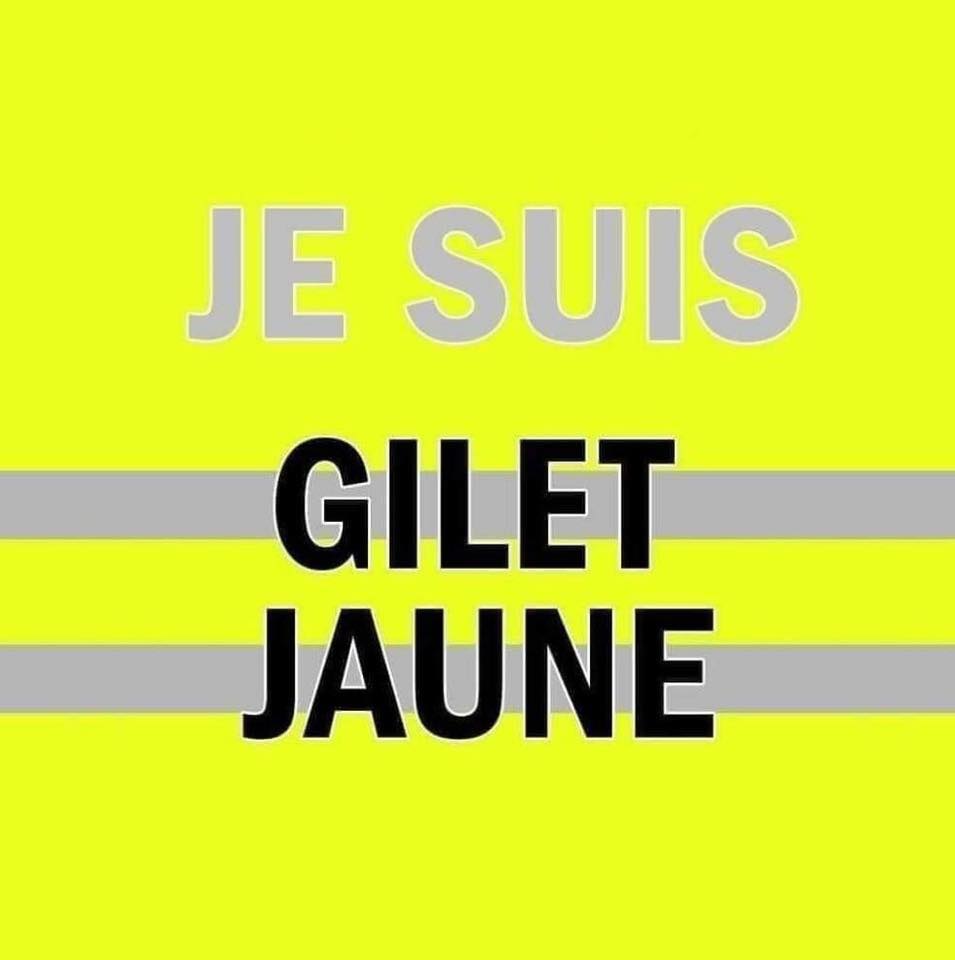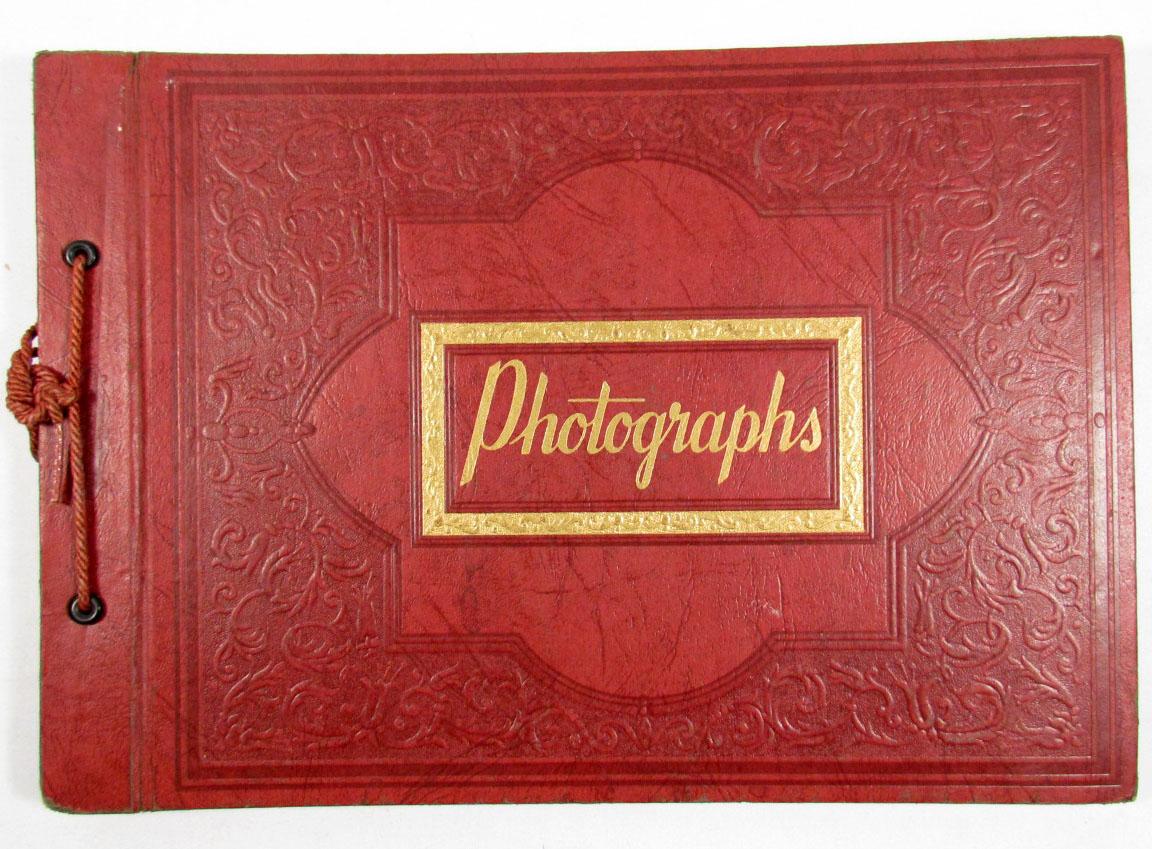ALZHEIMER FELIN
Journal International de Médecine du 19 septembre 2025
Le dysfonctionnement cognitif félin : un nouveau modèle de la maladie d’Alzheimer ?
Dr Philippe Tellier | 19 Septembre 2025
La démence féline partage des mécanismes neuropathologiques avec Alzheimer : accumulation d'amyloïde-β, inflammation, perte synaptique. Cependant, ce modèle a ses limites et sa place reste à définir.
Le dysfonctionnement cognitif félin (Cognitive Dysfunction Syndrome, DCF)se caractérise cliniquement par des troubles qui font évoquer une maladie neurodégénérative du chat âgé. Les modifications comportementales qui sont au premier plan se résument par une désorientation spatiale, des perturbations du cycle veille-sommeil, une anxiété manifeste et des troubles de la mémoire. Un tel tableau chez un chat qui prend de l’âge doit faire évoquer le diagnostic de DCF, la prévalence de ce syndrome étant voisine de 30 % entre 11 et 14 ans et atteignant 50 % à l’aube des 15 ans. L’IRM cérébrale révèle une atrophie corticale associée à une dilatation des ventricules cérébraux et des espaces sous-arachnoïdiens plus larges.
Force est de constater qu’il existe de nombreuses similitudes entre la démence féline et la maladie d’Alzheimer humaine, notamment quand il s’agit de leur forme évoluée. Les manifestations cliniques et leur évolution, leur corrélation à l’âge, ce qui les distingue du vieillissement cérébral dit physiologique créent une impression de parenté entre les deux syndromes. Les rares études autopsiques réalisées chez l’animal renforcent encore l’hypothèse, tout au moins dans une certaine mesure. Cependant, jusqu’où vont les similitudes ? Peut-on parler d’une maladie neurodégénérative en tous points identiques chez le chat et l’homme ? Quelle est la place exacte de la cascade amyloïde dans la pathogénie de la démence féline ? Quels sont les autres substrats neuropathologiques ?
Une étude anatomopathologique transversale : 25 chats déments, trois groupes
Autant de questions qui trouvent des réponses dans une étude transversale post mortem. Celle-ci a porté sur le cerveau de 25 chats de tous âges, dont certains atteints d’un DCF. Trois petits groupes ont été comparés, celui des cas de démence (n = 8), l’autre des participants jeunes (n = 7) ou âgés indemnes de troubles cognitifs (n = 10) avec appariement selon l’âge et le sexe.
L’examen anatomopathologique s’est focalisé sur le cortex pariétal qui, chez le chat, est une région du cerveau pour laquelle les plaques amyloïdes ont une certaine prédilection. Une étude immunohistochimie multiparamétrique (protéine Aβ, synapsine-1, glial fibrillary acidic protein – GFAP - et ionized calcium binding adaptor molecule 1 - Iba1) a été réalisée en complément d’une microscopie confocale et d’une quantification tridimensionnelle des images.
C’est ainsi qu’a été mise en évidence une accumulation significative de protéine Aβ et de synapsine-1 dans les synapses des chats âgés qu’ils soient ou non atteints d’un DCF, ceci comparativement aux jeunes chats. Une découverte qui plaide en faveur d’une toxicité synaptique directe de la protéine Aβ à laquelle il convient d’ajouter une microgliose régionale (avec augmentation des taux d’IBA1) et une astrocytose au voisinage des plaques amyloïdes. Par ailleurs, l’internalisation synaptique de la synapsine-1 et de l’IBA1 signe le rôle délétère de ces molécules, la microglie phagocytant préférentiellement des synapses contenant de la protéine Aβ. Il existe une corrélation étroite entre la charge amyloïde et la phagocytose synaptique uniquement en cas de DCF, cette anomalie n’étant pas observée chez les chats témoins.
Des similitudes avec la maladie d’Alzheimer, mais des limites
Selon cette étude, certaines données histopathologiques recueillies chez des chats atteints de DCF renvoient assez étroitement à celles qui caractérisent la maladie d’Alzheimer humaine. L’accumulation directe de protéine amyloïde-β au sein des synapses sous la forme d’oligomères synaptotoxiques est évocatrice, tout autant que leur phagocytose microgliale et, dans une moindre mesure, astrocytaire. Cette toxicité de la protéine Aβ qui est spécifiquement exacerbée au cours du DCF aboutit in fine à une perte neuronale médiée par la microglie qui est caractéristique de la maladie d’Alzheimer. De ce fait, le DCF pourrait constituer un modèle naturel de cette dernière, tout à fait adapté à la recherche translationnelle. Le petit nombre de chats inclus dans cette étude transversale, le manque d’informations précises sur l’état neurologique des témoins, la résolution spatiale limitée de la microscopie confocale, l’absence d’étude ultrastructurale par microscopie électronique sont autant de limites méthodologiques qui incitent à nuancer les conclusions.
Par ailleurs, sur le plan neuropathologique, les dépôts amyloïdes observés chez le chat sont souvent diffus et moins compacts que les plaques amyloïdes humaines, se rapprochant davantage de dépôts liés au vieillissement dit « physiologique ». La pathologie liée à la protéine tau, bien que décrite, reste à la fois inconstante et d’intensité plus modeste que dans la cascade neurodégénérative humaine, où elle semble constituer le principal déterminant du déclin cognitif. Sur un autre plan, le cortex cérébral du chat est plus simple que celui des humains et organisé différemment (bien éloigné du gyrencéphale humain) au point qu’il n’existe pas, chez l’animal, d’équivalents des circuits orbitofrontaux ou encore des voies impliquées dans la mémorisation ou les fonctions exécutives. Sur le plan clinique, les troubles cognitifs rencontrés chez le chat (désorientation, vocalisations nocturnes, malpropreté, etc.) sont tout de même bien éloignés de ceux qui caractérisent la maladie d’Alzheimer. En outre, l’absence des facteurs de risque propres aux humains ne permet pas d’étudier les interactions gènes–environnement.
Ainsi, le modèle félin, pour naturel qu’il soit, ne saurait remplacer ni les modèles murins transgéniques qui permettent des manipulations génétiques ciblées, ni les études de cohorte longitudinales chez les humains. Il n’en ouvre pas moins une fenêtre intéressante sur la complexité du vieillissement cérébral, tout en confirmant le rôle central des interactions Aβ-glie-synapse dans la cascade neurodégénérative. La place de ce modèle félin en recherche translationnelle préclinique reste clairement à définir.
References
McGeachan RI, Ewbank L, Watt M, et al. Amyloid-Beta Pathology Increases Synaptic Engulfment by Glia in Feline Cognitive Dysfunction Syndrome: A Naturally Occurring Model of Alzheimer's Disease. Eur J Neurosci. 2025 Aug;62(3):e70180. doi: 10.1111/ejn.70180.
Date de dernière mise à jour : 21/09/2025
Ajouter un commentaire